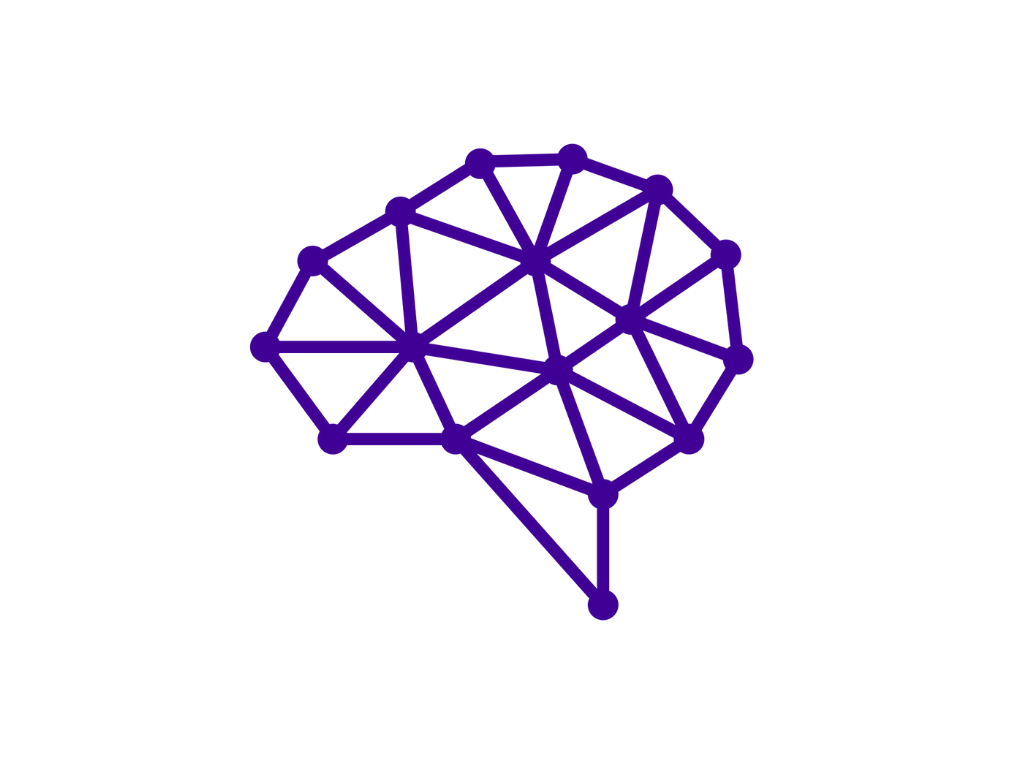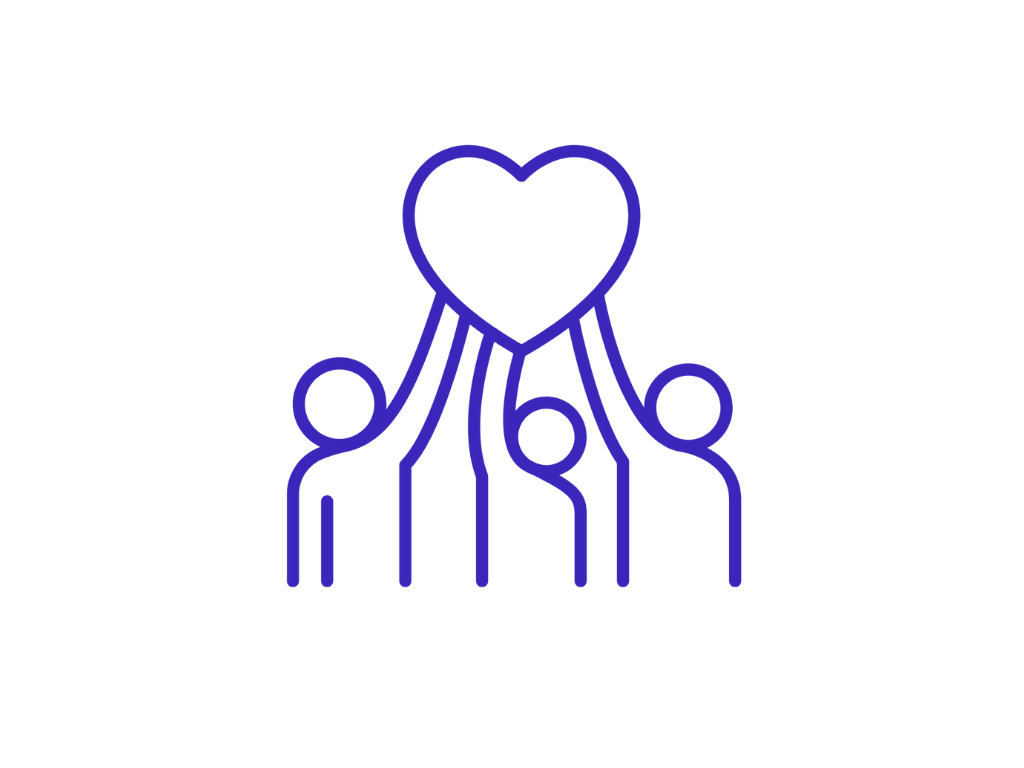L’année 2017 a été marquée par la réforme du code du travail avec les ordonnances signées en septembre. En 2018, cette réforme se poursuit. Le gouvernement veut modifier « l’objet social » de l’entreprise. Il s’agit concrètement de compléter les deux articles du Code civil qui définissent ce qu’est une entreprise. Aujourd’hui, ces articles limitent l’objectif de l’entreprise à l’intérêt des associés. Il est question d’y ajouter les autres parties prenantes : salariés, collaborateurs, donneurs de crédit, fournisseurs etc.
C’est dans ce contexte que le gouvernement vient de confier une mission à Nicole Notat, l’ancienne dirigeante de la CFDT, et à Jean-Dominique Sénard, le président du groupe Michelin. Le nom de cette mission, « Entreprise et bien commun », parlera évidemment à ceux qui sont attachés à la doctrine sociale. Cela fait quelque temps en effet, depuis Thomas d’Aquin, que la notion de « bien commun » occupe une place majeure dans la pensée sociale chrétienne. Dans Mater et Magistra, Jean XXIII avait donné cette définition du bien commun : c’est « l’ensemble des conditions sociales qui permettent et favorisent dans les hommes le développement intégral de leur personnalité ».
Le bien commun se distingue donc de l’intérêt général, mais aussi« des » biens communs ou biens publics, c’est-à-dire les biens dont la consommation par une personne ne réduit pas la consommation par les autres et qui sont à la disposition de tous dès qu’ils sont produits. Cette notion fait d’ailleurs également l’objet d’un regain d’intérêt, souvent via l’appellation de « communs » – et ce serait intéressant d’analyser cela à la lumière de la destination universelle des biens que défend l’Église, qui vise en fin de compte tous les biens et pas uniquement les biens communs.
Pour en revenir à la mission confiée à Mme Notta et M. Sénard, il faut souhaiter qu’elle puisse être alimentée par les apports de la pensée sociale chrétienne, qui depuis longtemps se soucie d’identifier les apports des parties prenantes de l’entreprise (clients, employés, dirigeants, actionnaires, pouvoirs publics, à la fois individuellement et collectivement, via les syndicats et organisations professionnelles) – avec toujours cette conviction que ces acteurs sont interdépendants et qu’il est donc nécessaire de rechercher l’équilibre, voire la convergence, d’intérêts qui, a priori, ne coïncident pas.
C’est tout l’enjeu de la réflexion en cours sur l’objet social de l’entreprise, qui suscite le débat. Elle est soutenue par le patron de Danone, Emmanuel Faber comme l’actuel secrétaire général de la CFDT. Mais elle suscite une franche hostilité du président du Medef Pierre Gattaz pour qui c’est « une mauvaise idée au mauvais moment ». On est tenté de penser que« mauvais moment » est de trop : si l’idée est mauvaise pour lui, le moment sera toujours mauvais…
Il y a pourtant, dans l’ensemble, un consensus sur la nécessité de mieux tenir compte des différentes parties prenantes de l’entreprise. Ce sont plutôt les modalités et notamment le recours à la loi, qui font débat.
Ainsi le vice-président d’Air Liquide, Pierre-Etienne Franc, reconnaît-il que « les entreprises doivent faire du bien commun le centre de leur stratégie » mais il estime que « plus qu’un changement d’objet juridique, c’est la valorisation financière des activités d’entreprises concourant au bien commun qu’il faut encourager ». Et selon le directeur de la rédaction de La Tribune, Philippe Mabille, « le meilleur moyen d’agir, dans ces domaines, ce n’est pas forcément la loi, mais le marché ».
Cette idée qu’il faut surtout « laisser faire le marché » prête à sourire, tant elle condense ce qu’il y a de plus caricatural dans le libéralisme. Mais ce serait trop simple de brosser un tableau en noir et blanc où les acteurs économiques seraient incapables de se soucier du bien commun sans contrainte de la loi.
Nous venons d’en avoir un exemple frappant aux États-Unis. Voici ce que Larry Fink, président de Black Rock, le plus grand gestionnaire d’actifs du monde, qui gère plus de 6 000 milliards de dollars, vient d’écrire aux entreprises américaines dans lesquelles il est actionnaire.
« Pour prospérer au fil du temps, toute entreprise doit non seulement produire des résultats financiers mais également montrer comment elle apporte une contribution positive à la société (…) Les entreprises doivent bénéficier à l’ensemble de leurs parties prenantes, dont les actionnaires, les salariés, les clients et les communautés dans lesquelles elles opèrent »
Voilà qui rejoint très exactement le débat français sur l’objet social de l’entreprise.
Le paradoxe, c’est que cette résurgence de la recherche du bien commun intervienne dans une période marquée par un individualisme profond – alors que cela suppose nécessairement une part de renoncement à la seule défense des intérêts individuels ou catégoriels. Mais il y a parfois loin de la coupe aux lèvres, et la prise en compte du bien commun par les entreprises est encore loin d’être acquise. Pour y parvenir, faut-il la loi ou le marché ? Là encore la pensée chrétienne oriente la réponse : ni la loi seule, ni le marché seul. Sans doute les deux ensemble, mais au-delà, rien ne sera possible sans une véritable « conversion intégrale », à la fois personnelle et communautaire, comme nous y invite Laudato Si.
—-
Par Pierre-Yves Stucki