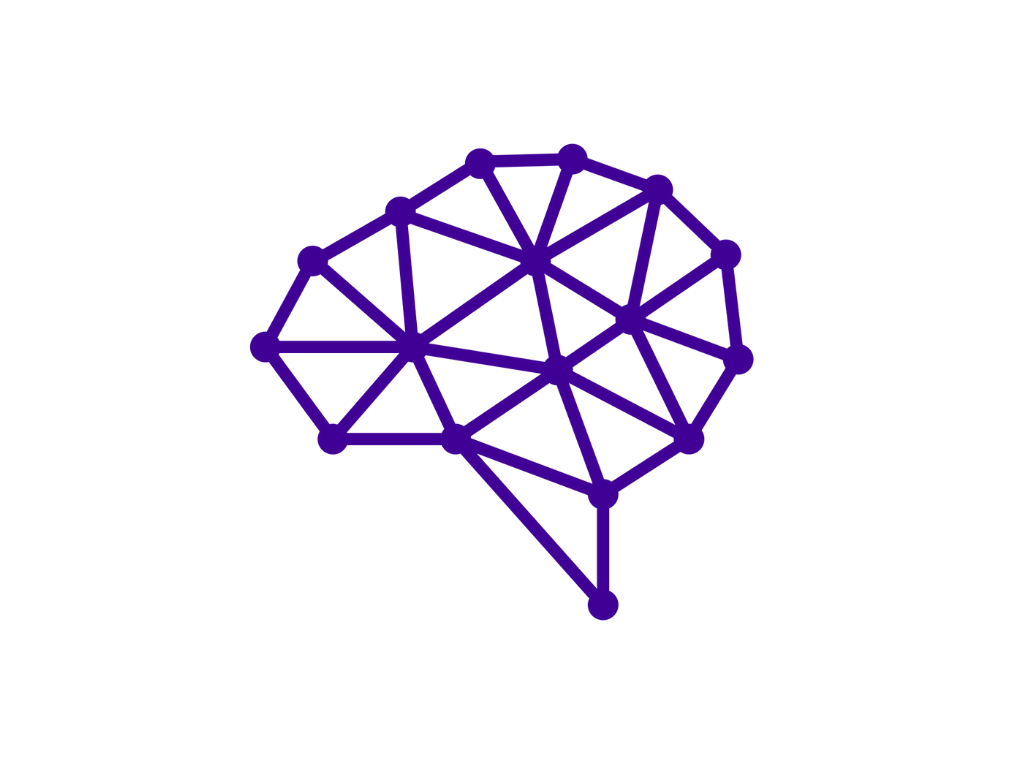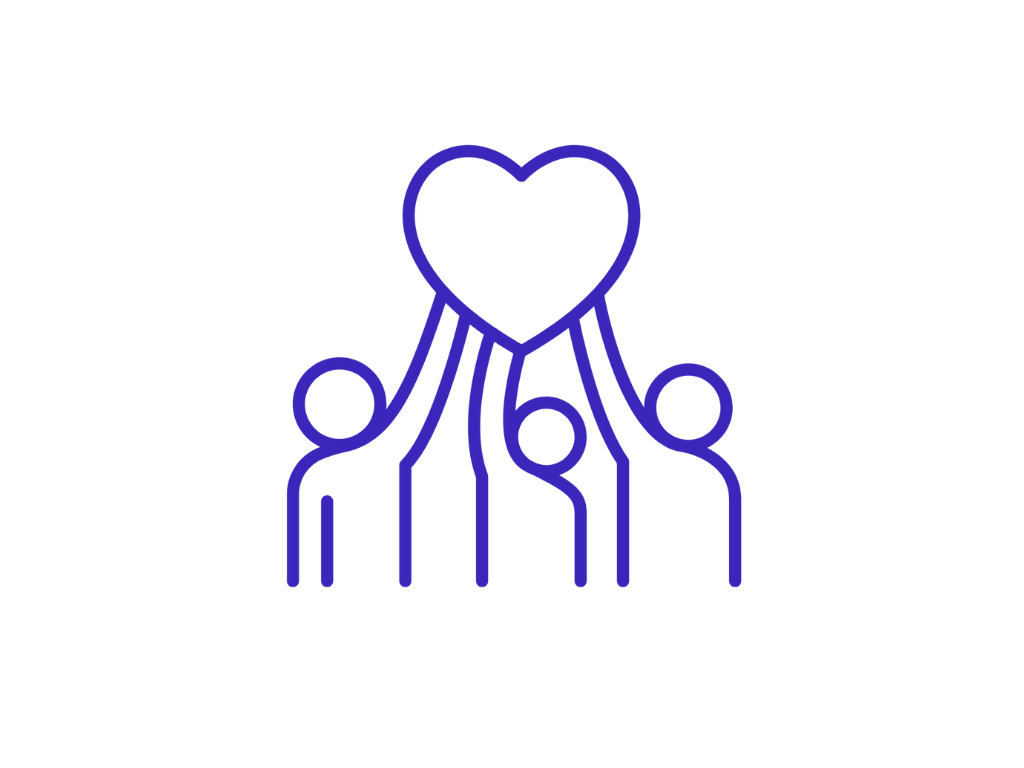Conférence donnée lors de la session 1996 des Semaines sociales de France, « Entre mondialisation et nations, quelle Europe ? »
Jacques DELORS, ancien président de la Commission des communautés européennes
À l’heure où, en Europe, le chômage atteint des proportions dramatiques, la tentation est grande de placer la construction européenne au banc des accusés.
On ne peut donc esquiver la question : avons-nous réellement trahi le projet économique et social de l’Europe?
Et, pour y répondre, un court détour par l’histoire et les acquis de la construction européenne s’impose. Non, rassurez-vous, pour me lancer dans une vaste justification de l’œuvre accomplie.
Mais il me semble qu’avant de fustiger sans cesse l’impotence de l’Europe sociale, il serait bon d’avoir l’honnêteté de comparer les résultats atteints aux ambitions initiales et aux objectifs qui les ont enrichis, à la suite d’initiatives, telles que l’Acte unique, dont on ne soulignera jamais assez le rôle crucial qu’il a joué pour relancer et rééquilibrer la construction européenne.
Autrement dit, j’entends prendre cette interrogation au pied de la lettre : quel était, quel est, le projet social de la Communauté, devenue Union européenne? Avons-nous réellement failli aux ambitions des pères de la construction européenne?
Quel était le projet économique et social de l’Europe?
Reportons-nous un instant en 1957, date de la signature du traité de Rome. À cette époque, la principale ambition des six pays fondateurs de la Communauté était l’édification d’un vaste espace de paix et de prospérité fondé sur la coopération politique et économique.
Les visées sociales étaient, elles, étroitement limitées à trois principaux domaines : la mobilité des travailleurs; la formation professionnelle ; l’égalité hommes-femmes.
Le traité de Rome : un cadre limité
La juridiction européenne s’ordonnait alors autour du Marché commun et des facteurs de production, dont le travail, d’où les dispositions déjà mentionnées du traité de Rome.
Il doit être clair, par conséquent, que l’établissement d’une sécurité sociale harmonisée ou d’un régime de relations industrielles supranational n’a jamais fait partie des missions de la Communauté.
De plus, dans aucun des secteurs visés par le traité n’existaient d’indications claires sur comment ,et quand l’harmonisation et la coopération pouvaient être achevées au niveau européen. Limitées et ambiguës, les bases légales pour agir (les articles 117 et 118 du traité) ont donné lieu à des interprétations contradictoires. Les opportunités d’action étaient faibles.
Et ce non pas tant parce que les Six ne croyaient pas à la nécessité d’une politique sociale, mais parce qu’ils estimaient qu’elle devait demeurer au cœur de la souveraineté nationale.
À l’époque, toutes les organisations sociales — partis politiques, employeurs, syndicats — faisaient de la nation leur point d’ancrage fondamental. Nous étions, en effet, dans la phase de consolidation des États providences modernes. Un socle social considérable était déjà en place, au niveau de chaque nation. De nombreux secteurs — santé, éducation, retraite — étaient ainsi, dès le départ, appelés à rester durablement soustraits au contrôle communautaire.
D’où un schéma institutionnel particulièrement contraignant, toute avancée reposant alors sur l’accord, le plus souvent unanime, des États membres.
C’est là, nie semble-t-il, un élément à garder toujours à l’esprit dès lors qu’on tente de dresser un bilan de l’Europe sociale : les demandes adressées à la construction européenne en la matière ont toujours dépassé de très loin ce qu’elle pouvait réaliser. Et, soulignons-le, ont toujours été très au-delà de ce que les États membres étaient prêts à accepter, en dépit des bonnes intentions affichées.
La relance de 1985
Cet état de fait n’a pas été fondamentalement altéré au cours du temps. Quand j’ai pris mes fonctions, en 1985, il était évident qu’aucun État membre n’était prêt à accepter une relance de la construction européenne qui viserait à transférer au niveau supranational les compétences en matière d’emploi, de sécurité sociale, de culture et de santé. Les États membres invoquaient, pour justifier leurs positions, les spécificités nationales, l’attachement de leurs citoyens à leurs droits et à leurs modalités spécifiques. Cette diversité de fait se reflétait aussi à l’intérieur des organisations européennes, qu’il s’agisse du patronat ou des organisations syndicales. C’est pourquoi j’ai rencontré des difficultés, lors de la relance du dialogue social, en 1985, pour rapprocher les positions entre les partenaires sociaux. Ceci dit, nous avons pu progresser, obtenir l’adoption de positions communes du patronat et des syndicats. Après sept ans de dialogue social, le terrain était mûr pour la mise en oeuvre du protocole social adopté en 1992 à Maastricht.
Peut-on dire pour autant que nous n’avons pas été à la hauteur du projet initial, qui visait avant tout, je le rappelle, à concilier intégration économique et progrès social ?
Il me paraît indispensable, si l’on veut réellement apprécier l’apport de la construction européenne à sa juste mesure, de sortir d’une conception étroite du social. Conception étroite, car limitée aux seules fonctions traditionnelles de l’État providence, fonctions qui ont toujours été et resteront, nie semble-t-il, l’apanage principal des États nations.
Car, enfin, la libre circulation des travailleurs, l’équivalence des diplômes, la possibilité donnée à chacun d’étudier, de travailler, de prendre sa retraite dans le pays de son choix, qu’est-ce, sinon l’Europe sociale?
La montée en puissance des politiques structurelles — de 5 milliards d’écus en 1985 à 30 milliards d’écus aujourd’hui — consacrées au développement régional, à la conversion des zones industrielles en difficulté, au développement rural, qu’est-ce, sinon l’Europe sociale?
Permettez-moi de m’arrêter un instant sur cet exemple car il me paraît significatif.
Bien qu’elle ne soit pas traditionnellement classée dans la politique sociale, la réforme des politiques structurelles doit bel et bien être vue comme la première grande tentative européenne d’affronter les inégalités par une redistribution programmée entre les États membres, par le soutien des plans de développement associant états nationaux, autorités régionales et partenaires sociaux. Comment prétendre, ici, que nous n’avons pas réussi à concilier progrès social et intégration économique?
Bien sûr, d’importantes disparités régionales demeurent. Mais l’expérience menée depuis 1989 a bel et bien démontré que ces politiques étaient le facteur décisif permettant aux pays les moins avancés de réaliser des taux de croissance supérieurs à la moyenne de l’Union. Dans les quatre pays dits de la cohésion —Espagne, Portugal, Grèce et Italie —, les fonds structurels représentent 30 % de l’investissement public total et 2,5 % des emplois. Les résultats ont pu, dans certains cas, être spectaculaires. Pensons simplement à l’Irlande dont le MB par habitant est passé de 64 à 90 % de la moyenne communautaire entre 1983 et 1995. En contrepartie, les pays les plus riches ont vu s’accroître leurs possibilités d’exportation et d’investissement dans les pays de la cohésion. C’est donc un jeu à somme positive.
On pourrait allonger la liste des exemples, car rares sont les politiques de l’Union dont une dimension sociale soit absente. C’est notamment le cas de la politique agricole commune, qui n’a jamais obéi aux seuls critères de la rationalité économique mais a bien visé non seulement à soutenir le niveau des revenus agricoles, mais aussi à veiller au maintien de nombreuses exploitations familiales, grâce notamment aux aides directes aux revenus.
J’ajoute que la France n’est pas oubliée, puisque les politiques structurelles couvrent 46 % du territoire. Beaucoup d’élus régionaux et locaux vous diront combien cette aide européenne est souvent décisive pour la mise en œuvre d’actions de développement ou de reconversion.
Par ailleurs, grâce aux dispositions de l’Acte unique de 1987 sur les conditions d’hygiène, de santé et de sécurité sur les lieux de travail, l’adoption, par exemple, de mesures protectrices face à des risques technologiques nouveaux tels le travail sur écran ou les biotechnologies, qu’est-ce, sinon l’Europe sociale?
Enfin, comment ne pas saluer, après des années d’effort, l’émergence des conventions collectives au niveau européen, avec deux accords, l’un portant sur le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les sociétés multinationales, l’autre sur le congé parental.
Bien sûr, plus que tout autre j’ai conscience des lacunes de la construction européenne. Bien sûr, d’immenses progrès restent à faite. Mais, non, nous n’avons pas démérité. Nous avons été aussi loin que les dispositions du traité le permettaient. Nous avons dépassé les ambitions originelles des pères fondateurs de la Communauté.
C’est pourquoi j’ai voulu en finir avec cette antienne de « l’Europe sociale, parent pauvre de la construction européenne ». Non, le socle social de l’Europe existe. À nous de le faire vivre, de le faire évoluer dans un monde en pleine mutation.
Un contexte préoccupant
Car, c’est désormais une évidence, le monde a changé. Le contexte économique et social du milieu des années 1990 est radicalement différent de celui du milieu des années 1950, et même de celui qui prévalait au moment du lancement de l’objectif 92.
Le drame du chômage est désormais devenu l’élément incontournable de toute réflexion sur l’avenir des politiques sociales, tant il est clair que l’inactivité sape la confiance des peuples, sans laquelle aucun grand projet collectif n’est possible.
Car nous vivons bel et bien aujourd’hui, n’ayons pas peur des mots, une véritable crise du sens social. Crise d’identité personnelle pour tous ceux qui se sentent rejetés en dehors de la société, bien sût., mais aussi crise d’appartenance de la société à elle-même.
Vous connaissez ma conviction : il me semble qu’aujourd’hui comme hier c’est avant tout au niveau national que pourra être efficacement menée la lutte contre le chômage et l’exclusion.
Nos États nations doivent s’appuyer sur une cohésion sociale qui renforce le sentiment d’appartenance, grâce à une solidarité renforcée entre tous les citoyens, ce qui implique que les nations conservent leurs compétences en matière de sécurité sociale, d’éducation et de formation, de politique du marché du travail… et aussi de politique des revenus.
Ceci étant dit, l’Union européenne n’en a pas moins un rôle essentiel à jouer pour créer un climat propice à la reprise de l’investissement, à la création d’emplois et au progrès social, pour apporter une valeur ajoutée aux politiques menées au niveau national.
Le défi des années 1990: l’Europe entre la survie ou le déclin
On peut, bien évidement, sourire de la formule, y voir la marque d’un pessimisme décidément excessif. Mais là est bien pour moi la question centrale, celle qui n’a cessé de nourrir ma vie de militant européen.
Je ne cesse de me la poser, aujourd’hui encore : oui ou non les pays européens veulent-ils échapper au déclin, et d’abord au déclin économique ? Sont-ils capables, sans se renier, d’adapter leur modèle économique et social ?
Car là est peut-être le cœur de notre projet économique et social d’aujourd’hui : bâtir une Europe puissante et généreuse à la fois.
Ce terme de « puissance » a plus d’une fois choqué mes interlocuteurs. Mais, de grâce, ne soyons pas dupes de nos bons sentiments. Aucune générosité, tant vis-à-vis de nos concitoyens que du monde extérieur, aucune générosité n’est jamais possible sans puissance.
C’est donc cette conviction — je dirais presque cette obsession — qui, dans une large mesure, a formé la grille d’analyse du Livre blanc sur croissance, compétitivité et emploi que la Commission européenne a soumis aux chefs d’État et de gouvernement au Conseil européen de Bruxelles, en décembre 1993.
Lire la suite…