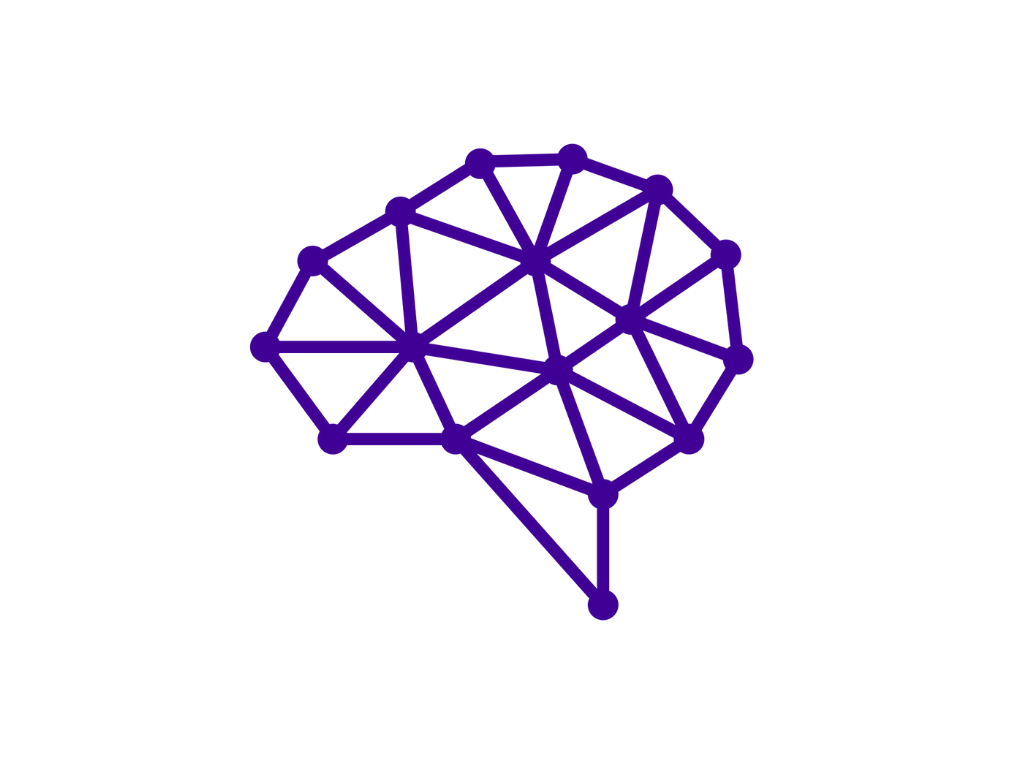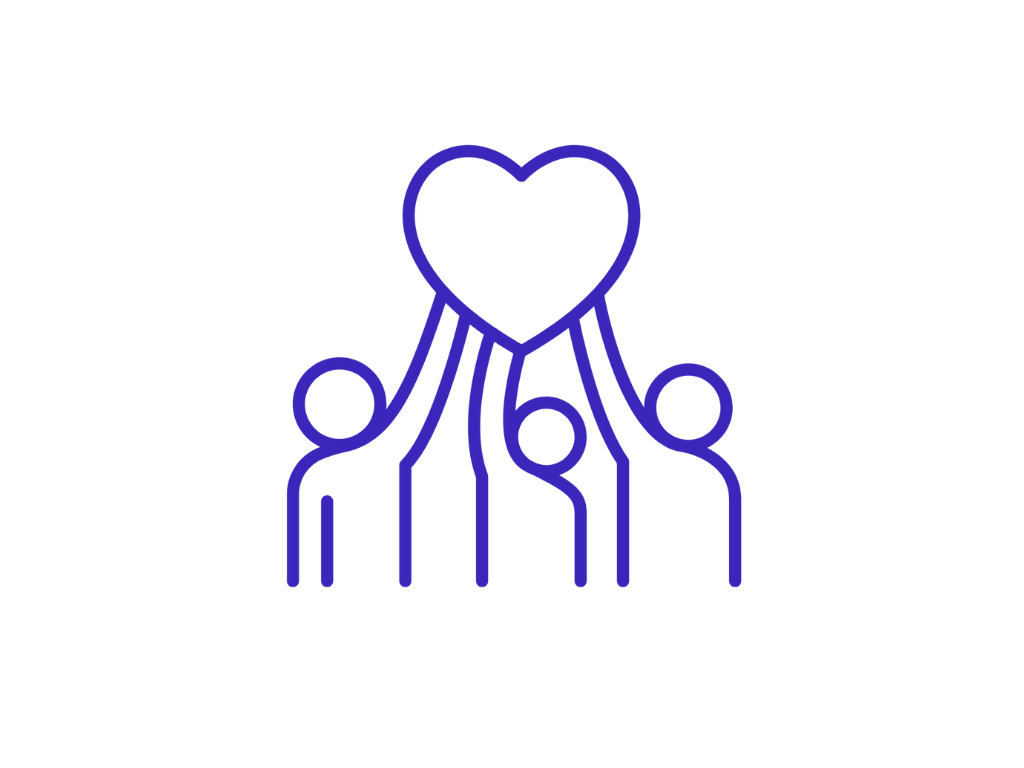Jean de Kervasdoué est économiste de la santé. Professeur émérite au CNAM et ancien Directeur général des hôpitaux. Nous remercions Jean de Kervasdoué de nous avoir permis de reproduire cet article publié dans Le Point du 3 novembre 2020.
***
L’épidémie provoquée par le SARS-COV19 bouleverse l’idée que l’on pouvait jusque-là se faire des politiques de santé. Les Français découvrent que la santé ne se limite pas, loin s’en faut, à la médecine, « médecine » et « santé » ne sont pas des synonymes. Le couvre-feu, la quarantaine, le blocage des frontières sont des mesures de police aussi anciennes que l’existence de villes ou des états qui ont été capables de les imposer. Le concept de quarantaine remonte à Hippocrate, et la fermeture des frontières, en France, date de l’ordonnance royale du 21 juin 1321 qui codifie l’exclusion des lépreux.
Jusqu’à cette année, les prouesses de la médecine du dernier siècle furent telles que la santé publique ne fut pas la priorité des gouvernements, pas plus d’ailleurs que celle des facultés de médecine. La médecine s’intéresse à des personnes qu’elle s’efforce de soulager, voire de guérir et pour cela, le médecin les prend en charge, les informe, les rassure et, bien entendu, quand il le peut, les soigne grâce aux outils diagnostics et thérapeutiques du moment.
La santé publique est d’une autre nature car elle a pour unité d’analyse, non pas une personne, mais une population atteinte d’une maladie (la grippe, l’accident vasculaire cérébral, la COVID 19…) ou d’un facteur de risque (surpoids, hypertension, …) dont elle va essayer de décrire la prévalence et la diffusion par des indicateurs démographiques (âge et sexe), géographiques (pays, région…), socio-économiques (revenu, éducation…), voire religieux et culturels. Ses outils sont statistiques et quasi-identiques à ceux de l’agronomie, de l’économie ou de la sociologie. Ses modes d’actions sont pour l’essentiels éducatifs (« Il faut manger cinq fruits et légumes par jour »), policiers (« Il est interdit de fumer dans les lieux publics » ; « la vitesse est limitée à cinquante kilomètres par heure », « il faut porter un masque en dehors de son domicile » …) et préventifs (vaccination…). Quand elle n’informe pas, quand elle ne prévient pas, la santé publique interdit et donc punit : la santé publique est par essence liberticide, même si elle préfère afficher sa dimension éducative.
On est donc bien loin de la définition bienpensante de la santé par l’OMS, répétée à l’envie depuis 1946 (1). Il me semble d’ailleurs que, plus qu’à la bonne santé, une telle définition incite à l’usage de drogues euphorisantes pour atteindre cet exceptionnel, sinon impossible « état complet de bien-être».
La santé publique a donc pour unité d’analyse un phénomène médical qu’elle tente de comprendre par des concepts issus des sciences sociales, de les analyser par des outils statistiques et d’en retirer un savoir pour agir par des outils éducatifs (Fumer tue) et juridiques (le glyphosate ne peut plus être vendu au public ; le couvre-feu commence à 21 heures, les enfants doivent se faire vacciner…). Elle s’intéresse ainsi à l’épidémie – c’est le terme – de l’obésité, aux raisons pour lesquelles le taux d’IVG baisse peu ou pas ou, enfin, tente de comprendre pourquoi on se suicide plus dans la Bretagne bretonnante (l’ouest de la région) que dans le pays gallo (l’est).
Le champ de la santé publique est immense. Il couvre tout d’abord le risque infectieux qui ne se limite pas à la compréhension des virus, des bactéries et des parasites uni ou pluricellulaires, mais s’intéresse aussi à leurs vecteurs : l’eau, l’air, les insectes les chauves-souris … Puis viennent tous les « risques » non infectieux : tabac, alcool, alimentation, toxicomanie, toxiques de toutes sortes dans tous les milieux et tous les lieux de travail…. Aujourd’hui, la bio-informatique tient aussi une place de choix en santé publique avec d’un côté la génomique et, de l’autre, la recherche de médicaments qui permettraient d’agir sur tel ou tel phénomène pathologique. Viennent enfin le droit de la santé et toutes les disciplines des sciences humaines et sociales : histoire, démographie, géographie, économie, sociologie, psychologie sociale … et, enfin, la philosophie explicitement ou implicitement invoquée.
Dans leur cabinet ou à l’hôpital, les médecins constatent les échecs de la santé publique. Ils soignent parce que l’on n’a pas pu prévenir la diffusion du virus et demandent au gouvernement d’agir quand ils craignent de ne plus pouvoir soigner tous les patients qui se présentent. Faute de pouvoir prévenir les effets d’une maladie dont on ignore tout, quand elle survient avec ce degré de gravité comment ne pas tout interdire ? Est-ce la seule voie quand l’isolement ne diminue rien d’autre que le nombre de patients hospitalisés ? Car, dès que les vannes s’ouvrent, le virus reprend son voyage de virus et ce d’autant plus vite qu’un faible pourcentage de la population est immunisé. Le seul espoir est que, durant ces semaines, ces mois qui viennent, les humains trouvent un moyen de combattre ce SARS-COV19 par des médicaments ou des vaccins.
Ceci n’est qu’un épisode des conflits entre médecins et spécialistes de santé publique et illustre l’analyse de Michel Foucault : « Il n’y a pas de relations de pouvoir sans constitution corrélative d’un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir… » (2). Pouvoir que beaucoup de médecins cherchent à capter : n’a-t-on pas vu des néphrologues venir parler doctement de virologie infectieuse et de santé publique ?
En attendant, comme souvent, le Gouvernement et ses experts quittent avec regret le champ de l’éducation et du discours moralisateur et recherchent l’acceptable, sinon le juste niveau d’interdiction. Il est vrai qu’en matière d’éducation pour la santé l’histoire enseigne la modestie. Les campagnes antialcooliques remontent à plus d’un siècle ; tous les fumeurs savent que fumer tue et les diabétiques n’ignorent pas que le sucre n’est pas bon pour leur santé. Mais les hommes ne vivent pas que pour vivre plus longtemps et les interdictions peuvent même donner une saveur particulière à ceux qui les enfreignent. « Le christianisme a beaucoup fait pour l’amour en en faisant un pécher », disait Anatole France !
En cet automne, les Français savent qu’ils courent un risque en se regroupant et que de surcroît ils en font aussi courir à d’autres, mais l’hygiénisme ne peut pas être leur seule philosophie, n’en déplaise aux écologistes.
Aussi, à ce stade, l’époque des choix fatidiques se prolonge et n’apporte qu’une certitude : le Gouvernement et le chef de l’Etat seront critiqués parce qu’ils en auront fait trop ou … pas assez et, alors, beaucoup chercheront des coupables. Il faudra conjurer la démonstration de notre impuissance et prétendre qu’elle aurait pu ne pas être.
Jean de Kervasdoué
(1) « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (OMS, 1946).
(2) In, André Scala, « Notes sur l’actualité, le présent et l’ontologie chez Foucault », Les Cahiers de Philosophie, no 13, 1991.