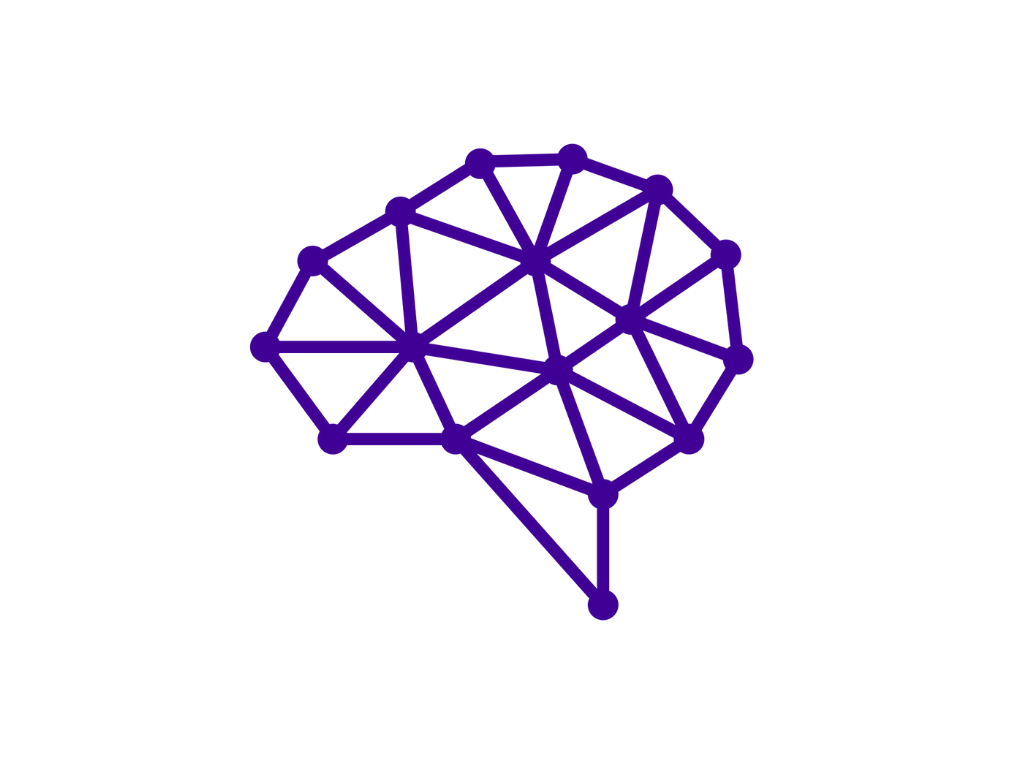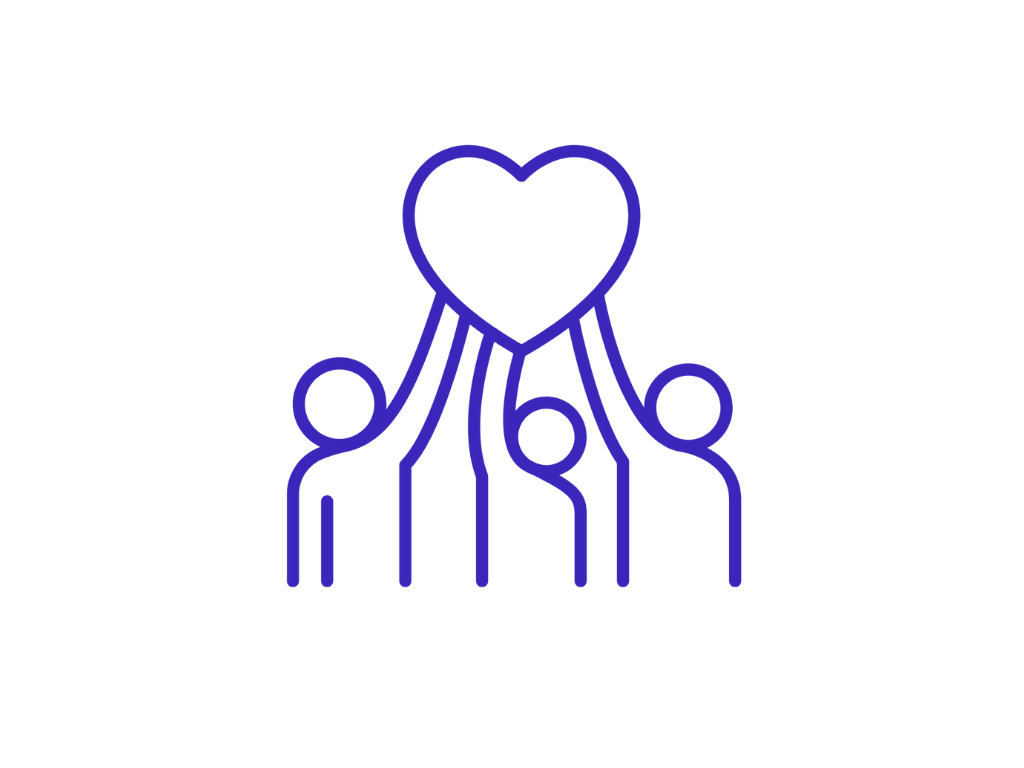Ce que vous avez reçu de vos pères, vous le transmettrez à vos enfants
Par Michel Camdessus
Conclusion de la session 2005 des Semaines Sociales de France, « Transmettre, partager des valeurs, susciter des libertés »
MICHEL CAMDESSUS, président des Semaines Sociales de France.
Merci pour ces trois jours d’échanges. Vous vous y êtes généreusement et courageusement livrés, conscients que la crise de transmission que nous traversons touche au plus profond de notre vie collective, qu’il s’agit de sauver les chances d’un pays fraternel. Nous nous sommes attachés à dépasser les lamentations, à discerner ce que les événements nous disent, à entendre les remises en cause qu’ils appellent, à rebâtir une confiance, à nous ressourcer dans la difficile Espérance.
Qu’avons-nous mieux compris de la transmission ?
D’abord qu’elle est essentielle : elle est ce qui permet à l’enfant de revêtir son humanité ; mais elle n’est possible que dans une confiance mutuelle qui implique le changement de celui qui reçoit et de celui qui transmet ; elle est rencontre d’une parole et d’une liberté, d’une parole authentifiée par une vie et d’une liberté irréductible. Elle appelle des passeurs qui méritent cette confiance et qui puissent engendrer liberté et confiance dans l’avenir. Une condition à cela : que celui qui transmet accepte d’accueillir la culture dérangeante de celui qui reçoit, qu’il accepte de « s’y faire », au sens fort de ces mots, parfois dans un travail de deuil et d’abandon d’habitudes, pour s’ouvrir à un futur incertain… C’est là le prix de la transmission. Prix qui ne doit pas nous effrayer car c’est le prix même de la survie de nos sociétés. Car transmettre, c’est perpétuer la vie ; c’est par la transmission que les sociétés humaines se reproduisent. Elle ne peut donc pas être un long fleuve tranquille !
Chassons l’illusion de la transmission sans peine, de la reproduction à l’identique de génération en génération, cela relèverait du clonage, non de la vérité de la vie des sociétés. Il n’y a pas de transmission sans crise. « La crise du transmettre, c’est notre condition même ! » (Maurice Bellet). Nous sommes simplement au pied du mur après tant d’autres, face à un défi que l’homme connaît de génération en génération et que notre temps rend simplement plus intense par la rapidité des changements et ce sentiment que, dans beaucoup de domaines, le monde touche à ses limites, à la finitude de ses ressources.
Tous les forums en ont souligné quelques aspects essentiels. La transmission souffre de certains aspects de notre temps de vitesse et de recherche unidimensionnelle d’efficacité. Elle ne vise pas le résultat immédiat ; son temps est le temps long, celui des germinations. Elle nous invite à être habités par l’urgence et pourtant à prendre notre temps, ce temps long donné à notre génération. Et aux parents que la tristesse étreint d’avoir échoué dans la transmission de biens spirituels tels que la foi, je répète ces mots de Xavier Lacroix : « Il est impossible que les biens qui pour nous sont vitaux, indissociables de notre vie, ne soient pas reçus avec la vie par nos enfants. Ils sont comme une semence qui germera en temps voulu, un temps qui n’est pas le nôtre. Nous ne sommes pas maîtres des fruits de ce que nous semons. Car, selon Saint Paul, celui qui plante n’est rien, celui qui arrose n’est rien, mais c’est Dieu qui fait croître ».
Disons-le autrement, la transmission n’est pas de l’ordre du formatage ou de la pression collective, mais de la relation interpersonnelle ; elle n’est pas de l’ordre de l’effraction, mais de l’extrême délicatesse et de ce tact dont Jésus est le maître absolu. Même si l’exemplarité lui est essentielle, elle est confiée aux transmetteurs improbables, aux passeurs non exemplaires que nous sommes. Bref, elle est de l’ordre de l’engendrement, ce mot répété plusieurs fois dans des contextes différents. Finalement, elle vise à ce que passe l’essentiel, la vie, et ce qui fait la vie humaine, la relation qui fait qu’on peut s’aimer soi-même et aimer les autres : l’amour.
Une crise de transmission
Plus que panne – pour la société comme pour l’Église – il y a crise. L’idée de panne suggérerait qu’il y a interruption mais qu’après un dépannage, on puisse repartir à l’identique. Non, il y a crise avec un grand « C », c’est-à-dire un mélange détonnant de grands périls – de périls mortels – et de chances nouvelles, immenses peut-être, mais qui doivent être discernées et qui, pour être saisies, appellent des changements profonds à la mesure des périls courus.
Cette crise, en France – et à des degrés divers dans d’autres pays d’Europe – est générale. Elle touche tous les secteurs de la vie et pas seulement le mien ou le vôtre ; elle affecte de même façon les Églises et la société. Crise de l’engagement dans la vie associative, syndicale, politique : « il est clair , disait hier Yolande Briand (Secrétaire générale de la CFDT Santé-Sociaux, intervenant dans le forum Vie associative), que l’appétence de chacun à se reconnaître dans un projet collectif a, pour le moins, faibli au profit d’intérêts catégoriels et du repli sur soi ». Crise de l’école : comment pourrait-elle transmettre des valeurs d’égalité et de justice, si elle n’est elle-même lieu de joie dans le travail, si elle n’est ni juste, ni équitable ? Comment pourrait-elle être, surtout aujourd’hui, lieu de personnalisation des enfants, si elle ne parvenait pas à mieux personnaliser son enseignement ? Crise pour les Églises et, notamment dans notre pays, pour l’Église catholique : avec la montée de l’individualisme, du relativisme, mais aussi en réaction contre des formes étouffantes de cléricalisme, la société s’est sécularisée. Les Églises se vident, les vocations religieuses se raréfient et l’on nous parle de « déculturation catholique ».
Quel avenir lire dans ce constat ?
D’abord, évidemment, que la panne de transmission est la question essentielle posée aux chrétiens mais qu’il y a aussi un lien très étroit entre la crise que connaît l’Église et celle que traverse la société. Et réciproquement. D’abord parce qu’aucune société ne peut survivre sans ce ciment de sagesse, de convictions collectives, qui se transmet de génération en génération, qui la maintient debout et lui donne assurance devant son avenir. Sans ce ciment – et la croyance religieuse en est partie intégrante – l’édifice social se déconstruit, l’homme est laissé seul, sans même cet essentiel à transmettre : le goût de la vie. Jean-Claude Guillebaud l’a dit bien mieux : « La croyance n’est pas un élément ajouté à l’humanisation, mais le fondement de celle-ci».
Mais la réciproque est tout aussi vraie. Les Églises partagent un problème global des sociétés où elles s’incarnent ; elles ne le surmonteront qu’avec elles. Pourquoi ? Parce que comme Christoph Theobald l’a si bien montré, « l’intérêt évangélique de l’Église ne peut plus être d’abord sa propre reproduction, mais la vie des femmes et des hommes de notre temps et la consistance du lien social qui les relie… bref, la foi en la vie qui permet aux humains de donner forme à leur vivre ensemble ». L’Église et la société sont unies dans une épreuve commune et un objectif commun dans leur service des hommes. Établir ou rétablir le « lien primordial » est leur défi commun. C’est ici qu’il nous faut nous arrêter un instant, à cette crise dite des banlieues. Dite « des banlieues », parce que si les banlieues portent ce symptôme d’une société éclatée, le mal est – à des degrés plus ou moins avancés – mal de toute notre société ; il nous appelle à ouvrir grands les yeux sur ce que beaucoup de témoins nous disaient depuis longtemps, sans que nous acceptions de le voir.
Nous savions et déplorions que le lien social se fracturait. Savions-nous qu’en bien des lieux, il n’existait même pas ! On nous disait que « le traitement que nous réservons aux jeunes est un véritable symbole de nos dysfonctionnements… qu’ils sont les grandes victimes de l’absence d’adaptation de notre modèle social ». Mais quelles conséquences en tirions-nous ? Avons-nous mesuré le non-espoir de ces jeunes qui n’aperçoivent guère en quoi ils sont partie d’une République où ils aspirent au respect, à exister, à être écoutés, à trouver une chance d’accéder normalement à un avenir et pour qui tout est bouché, parfois seulement du fait du prénom qu’ils portent ou du numéro de leur département ? Comment y aurait-il sens et repère pour eux, identité même, puisque c’est leur nom qui les exclut ? Les voici voués à une sorte de repliement du corps social ou à la révolte sauvage et sans discours, repliement autiste auquel correspond, hélas, notre long déni collectif, notre autisme collectif. Bien sûr, dans ce temps de répit qui s’amorce, de nouvelles mesures vont être prises, des crédits seront mis en place, mais maintiendrons-nous notre effort assez durablement, ferons-nous en sorte que chacun se sente objet d’attention personnelle, d’une attente fraternelle de l’autre, qu’un horizon lui soit ouvert, que l’art du vivre ensemble soit très patiemment retrouvé ? Alors seulement, les valeurs de la République auront une chance de se perpétuer à nouveau. Il y a urgence, évidemment, est-ce bien la peine de le dire ? Il n’y aura pas de remède miracle. C’est nous tous, toute notre société, qui doit faire retour sur elle-même, et face à de tels dangers, repérer et saisir les chances nouvelles.
Lire la suite et téléchargez le pdf