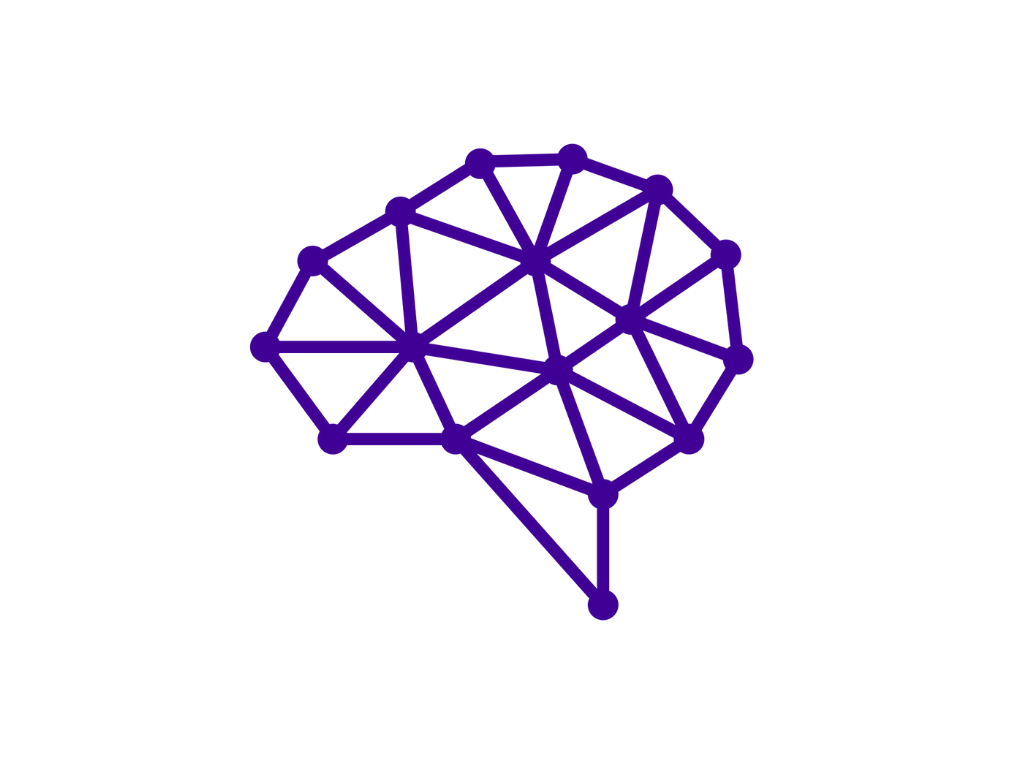Xavier Emmanuelli : Médecin, président du SAMU social de Paris, ancien secrétaire d’Etat à l’Action humanitaire d’urgence
Il est très difficile de parler de soi et de ce qui est à la fois un itinéraire professionnel et un itinéraire d’espérance. À soixante-trois ans, on a le droit de se retourner et de se demander: « Qu’est-ce que j’ai fait ? Est-ce que cela a eu un sens ? » Je suis un médecin de l’urgence, c’est-à-dire que j’ai eu le privilège d’assister à la naissance de ce concept d' »urgence », et à la possible réponse à cette urgence qu’était l’apparition des SAMU. J’étais l’un de ceux qui y ont participé et qui ont fait la rencontre de cette pathologie des premières minutes que seuls connaissaient les médecins militaires, celle dont souffrent les victimes d’accidents de voiture ou d’accidents domestiques, auxquelles on ne demandait plus de se déplacer pour venir à l’hôpital. J’ai fait des rencontres pathétiques, mais j’ai appris des choses et j’ai su faire des choses. Dans ma spécialité, je suis un expert de l’urgence, un vrai professionnel. Au cours de toutes ces sorties de nuit, toutes ces veilles en réanimation, je me suis dit que j’ai probablement sauvé des centaines de vies – c’était mon métier et j’étais payé pour ça. Et j’ai été l’homme le plus important de l’existence des gens que je soignais, parce que la Providence m’avait placé sur leur chemin. J’étais un bon professionnel, et la mort était pour moi un échec. Mais je n’ai rencontré personne, je n’ai pas eu de dialogue avec les gens. Alors que mon père, qui était médecin généraliste – guérisseur, à sa façon -, était un accompagnant fraternel, c’est-à-dire qu’il savait rester auprès des gens, les faire évoluer et évoluer avec eux. Il accompagnait toutes ces phases difficiles de la douleur, de l’agonie, ou même du bonheur. C’était un vrai médecin; moi, j’étais un technicien. Mais je suis content de l’avoir été, cela a fait progresser l’hôpital et, d’une manière générale, la santé. Lorsque j’étais médecin praticien hospitalier à l’hôpital de Nanterre, j’étais toujours dans cette quête de ce que ma profession et mes actes aient un sens. Et là, la police amenait – et continue à amener – les gens qui étaient ramassés, raflés dans la rue ou dans le métro: les clochards, ceux qu’on appelle les sdf, les très grands exclus. Cela m’a fait grandement réfléchir sur la grande exclusion et sur notre propre exclusion et aliénation.
Lorsque ces gens m’étaient amenés, j’allais les voir lorsqu’ils étaient sous la douche, parce qu’ils ne demandaient pas de consultations. Ils avaient des lésions épouvantables, des ulcères géants, des malnutritions, ils étaient efflanqués, couverts de poux, de gale, mais ils ne demandaient rien. Quand je voyais ces corps dans cet état, je n’arrivais pas à y croire. J’avais déjà rencontré des lésions pareilles dans le fin fond de l’Afrique, là où il n’y a pas de médecin, mais en 1992-1993, en plein Paris, avec le système de santé qu’on a, voir des lésions comme cela me paraissait impossible. Et pourtant, ces gens étaient là, dans cet état pitoyable. Je les sollicitais en leur disant: « Venez me voir, venez à ma consultation. » Ils venaient pour me faire plaisir, mais il n’y avait pas de plainte. Je me disais: « Quand même, au moindre bobo, je me pose des questions et je vais voir le médecin. Pourquoi n’ont-ils pas consulté ? » Je crois qu’ils ne l’ont pas fait parce que, par notre comportement, nous ne leur donnions pas les moyens de le faire. La grande exclusion nous dit cela. Parce que, si ces gens, qui sont dans une saleté repoussante, avec des comportements aberrants ou agressifs, avaient osé transgresser, osé pousser la porte du cabinet de consultation d’un médecin, ils n’auraient pas pu être reçus. Toute la salle d’attente se serait levée et serait partie en disant: « Mon médecin est le médecin des clochards, il n’est pas pour moi. » Ils savaient, implicitement, qu’ils ne pouvaient pas aller au café, au cinéma, dans les lieux publics, dans le métro, qu’ils étaient indésirables. Ils avaient compris que les institutions n’étaient pas faites pour eux. À force de comprendre, et pour ne pas affronter le rejet, ils étaient restés avec leur mal. Je me disais: « Ils ont quand même un problème d’image, on voit quand son propre corps se défait, quand le corps souffre. » Eh bien, non: ils étaient devenus invisibles à leurs propres yeux. Dans le métro, lorsque des clochards sont affalés sur un banc, sentant le vin, personne ne vient se mettre à côté d’eux. On fait un petit détour pour les éviter, et puis on a un regard décent, social, on fait comme si on ne les avait pas vus. Or, quand on n’existe pas dans le regard des autres, on finit par ne plus exister à ses propres yeux. Ils savaient qu’ils étaient rendus invisibles, donc ils se rendaient eux-mêmes invisibles. Ainsi petit à petit, l’image de leur propre corps était atteinte. C’est cela la grande exclusion: lorsqu’on n’a pas d’image sociale, que l’on n’existe pas pour les autres, alors petit à petit on perd les repères du temps et sa propre image. Aujourd’hui ressemble à hier, qui était un jour gris, sans espoir et plein d’agression. On n’a pas envie de penser à demain, parce que demain sera pareil. On perd donc la notion de la durée et du temps. Les médecins qui les prennent en charge par la suite disent: « Mes malades ne viennent pas au rendez-vous. » Qu’est-ce que cela veut dire ? Quand mardi ressemble à jeudi ou à vendredi, tout est très loin, irréel. On perd le temps, on perd son corps, et on sait très bien qu’on ne pourra pas s’exprimer. On sait très bien qu’aux urgences de l’hôpital, entre ces gens très étranges, agressifs, qui présentent une espèce de danger potentiel, et quelqu’un de bien habillé, paraissant normal, on fera passer d’abord ce dernier, qui ne représente pas une menace, ni pour soi ni pour les autres.
On est exclu parce qu’on s’exclut des autres, mais après on s’aperçoit que nos institutions, l’hôpital d’un côté, la psychiatrie de l’autre, l’hébergement en troisième, abritent une espèce d’idéologie folle de réinsertion: « Vous êtes dans cet état-là: montrez-moi votre projet de vie, votre enthousiasme, et je pourrai faire quelque chose. » Mais il n’y a pas d’enthousiasme, tout est cassé. Il n’y a pas de projet de recadrage. L’exclusion a souvent des raisons économiques, mais elle n’est pas d’ordre économique. Il ne suffit pas d’être sans moyens, pour être exclu, il faut encore autre chose: il faut avoir perdu le contact avec les autres. Après, au fur et à mesure que la personne s’enfonce dans ce non-sens, son dynamisme s’use. Et il ne suffit pas de donner des pensions, des formations, c’est bien plus compliqué: il faut une raison d’être en vie et d’être en ville. Il faut donner les moyens d’avoir envie de goûter la vie. La réinsertion n’est pas une réinsertion économique, mais une réparation psychique. Une fois que le désespoir s’est installé, il est très difficile de réparer, de donner de l’espérance, du sens. Où aller: vers l’hôpital, vers le centre d’hébergement, vers la psychiatrie ? Est-ce qu’on y va volontairement ? Au bout d’un moment on tombe dans une espèce de fatalité: tout est écrasant, il n’y a plus d’initiatives à prendre, et l’exclusion entraîne l’exclusion. Ne croyez pas que seuls les grands clochards sont comme cela.
Il me semble que chacun d’entre nous est souvent aliéné par rapport aux autres: il suffit de voir les personnes âgées, par exemple, quand elles perdent leurs relations, leur surface sociale, de travail, les échanges avec les autres, leurs relations affectives. Petit à petit l’espace se réduit, et on n’est plus vu, on ne cherche plus à plaire et personne ne vous plaît non plus, on s’exclut donc les uns des autres. Nos institutions, qui sont faites pour traiter, pour réparer, n’arrivent pas à saisir les gens qui perdent pied dans leur solitude.
On a tellement l’habitude de penser qu’il y a les exploiteurs et les exploités, en termes de lutte des classes, comme si les exclus étaient une classe homogène et que quelque chose ou quelqu’un les avait poussés là, mais en réalité il ne s’agit pas de cela. L’exclusion n’est pas l’exploitation, mais la perte de sens, de liens, d’affection. La réinsertion, c’est commencer à remettre debout, psychiquement, les gens, et après, quand ils ont réacquis l’enthousiasme et l’envie de vivre, on peut faire ce qu’on veut. Et là il faut donner un coup de main économique, des possibilités de formations, alors on peut penser à des retrouvailles avec la société. Malheureusement nos mécanismes institutionnels ne sont pas faits comme cela: on ne répare pas les psychismes, on ne répare pas les gens qui ont perdu les clés du réel, qui ne se voient plus, qui n’ont plus de raison de se voir. Il y a trop longtemps qu’ils ont connu l’échec: échec familial, échec d’apprentissage, échec scolaire, échec avec l’hôpital, avec l’hôpital psychiatrique. Le psychiatre français, Alexandre Vexliard, indique en 1957 quatre phases dans l’exclusion: la première phase est une phase d’agression, comportant questionnement face au rejet et revendication. Plus on agresse, plus on est rejeté. Au bout d’un moment, on entre dans la deuxième phase, qui est une phase de dépréciation, qui consiste en ce que l’individu se croit responsable du fait d’être rejeté. C’est là où les actes manqués et les facteurs d’échec se succèdent, créant une situation qui conduit souvent les gens vers des anxiolytiques comme l’alcool. Puis vient une troisième phase, tout aussi dangereuse, qui est une phase d’acceptation. Nous entrons dans la légende du clochard philosophe: « Je suis nul, mais je revendique ma liberté. J’ai choisi ma vie et je vais où je veux. » C’est un retournement narcissique très dangereux, parce que le pire ennemi de sa réinsertion, c’est lui-même. Finalement, la quatrième étape, phase d’abandon, marquée par le désespoir et la déchéance, est celle lors de laquelle le Samu social intervient.
• Téléchargez le pdf