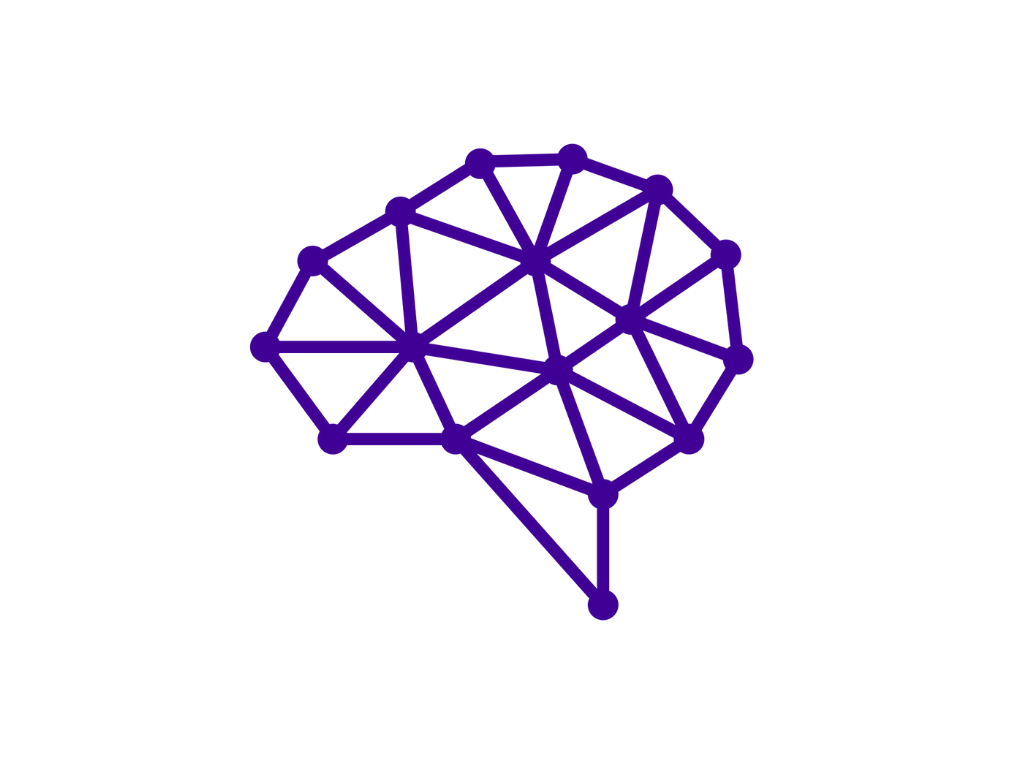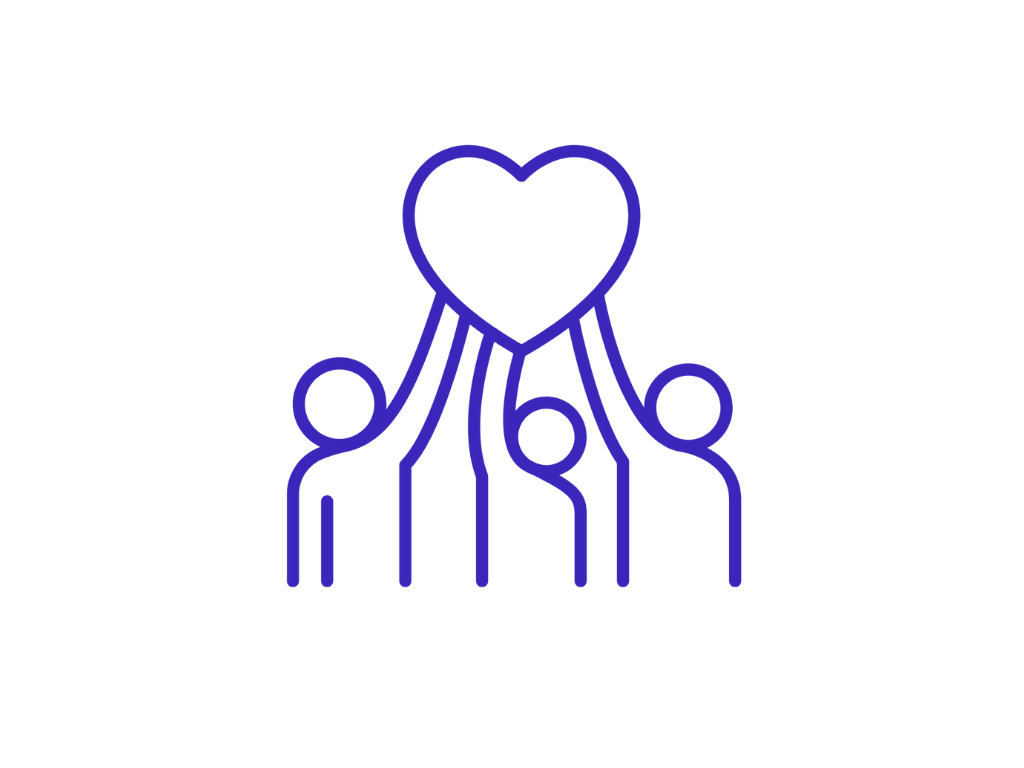Par Geneviève Jurgensen
Conférence donnée au cours de la session 2002 des Semaines Sociales de France, » La violence, Comment vivre ensemble ? »
GENEVIEVE JURGENSEN, journaliste, fondatrice de la Ligue contre la violence routière.
I. La genèse d’un engagement.
Après m’être interrogée ces derniers jours sur le discours spécifique que je devais tenir devant un public catholique, il m’a semblé pouvoir dire que je ne me souvenais pas d’avoir entendu Jean-Paul II s’exprimer sur les accidents de la route, qui sont pourtant dans le monde occidental la première cause de mortalité de la jeunesse, qu’il aime tant et qui le lui rend avec une telle ferveur.
J’ai été contente d’apprendre que Mgr Dubost avait célébré récemment une messe à l’intention de tous les blessés. C’est une bonne initiative, parce que les associations militantes contre la violence routière ont beaucoup de mal à évoquer les blessés. Elles savent qu’ils sont nombreux, elles connaissent bien les conséquences, mais les blessés forment une population difficile à cerner et leurs familles sont moins militantes que les familles endeuillées, parce que leur vie est trop difficile. Dès lors qu’il y a un handicapé dans la famille, les soucis de vie quotidienne et d’argent, l’angoisse de l’avenir sont tels qu’on ne peut pas attendre légitimement un engagement militant pour une cause générale.
Invitée parmi vous en tant que « grand témoin », il m’a semblé que je devais honorer cette qualification en témoignant véritablement, c’est-à-dire en vous présentant la genèse d’un engagement et en vous disant ce qui s’est passé chez nous et que je passe d’habitude sous silence devant les médias. Si je me tais d’habitude, c’est que cette cause serait tout aussi juste si je n’en avais pas été si directement victime, avec mon mari, mes enfants, et la totalité de ma famille, et que l’on ne reste pas – vingt-et-un ans pour ce qui me concerne – attelé à une tâche aussi ingrate pour des raisons personnelles. On le fait parce qu’on sait que c’est une cause juste et importante, qu’on se croit capable de la défendre, et qu’on sait – c’est la raison principale – que si on ne le fait pas soi-même, on condamne quelqu’un d’autre à le faire à sa place.
Tout a commencé le 30 avril 1980. J’étais avec mon mari seule à la maison. Le téléphone a sonné, nous n’attendions pas d’appel. J’ai décroché et quelqu’un m’a dit : » Vous êtes bien Madame Jurgensen ? » Depuis, je pense toujours que j’aurais aimé pouvoir lui dire : » Non, ce n’ est pas moi, je vous la passe « . À partir de cet instant-là, à partir de ce moment où j’ai dû répondre » oui « , il m’a fallu devenir cette personne que le correspondant recherchait, et que je ne savais pas que j’étais au moment où il m’a posé la question : » Vous êtes bien Madame Jurgensen ? « . Il voulait parler à quelqu’un qui venait de perdre ses deux enfants, et j’ignorais encore que c’était moi.
Mes filles, âgées de sept et quatre ans, étaient parties avec leur oncle, leur tante et leur cousine, bébé, rejoindre leurs grands-parents. Un jeune homme a perdu le contrôle de sa voiture, un jeune homme dont les personnes qu’il venait de dépasser pensaient qu’il provoquerait une catastrophe. Mes enfants ont trouvé la mort sur le bord de l’autoroute, assez loin l’une de l’autre, semble-t-il. Dieu merci, mon beau-frère, ma belle-sœur et leur bébé ont été épargnés, ainsi que le jeune homme. C’était donc un malheur qui avait fondu sur ces deux petites filles, et sur elles seules.
Le problème qui s’est présenté à nous immédiatement a été de nous hisser à la hauteur de ce qui se passait. Nous sentions que nous n’avions pas l’enveloppe nécessaire pour abriter un événement de cette dimension qui, minute après minute, se révélait dans sa réalité. Mon premier geste a été de fermer la porte de la chambre de mes enfants, qui baillait sur le couloir où se trouvait le téléphone. Après, nous nous sommes rendu compte qu’il fallait aller là-bas, en Picardie où étaient nos enfants, mais nous ne savions pas qu’aller y faire, puisqu’elles étaient mortes… J’ai compris aussi qu’il fallait que je prévienne ma mère. Nous allions donc de découverte en découverte.
Avant de parler de sécurité routière, j’aimerais dire qu’il faut que chacun soit convaincu, dans l’entourage proche ou moins proche, parmi les relations de voisinage, les relations professionnelles, de son immense utilité. Combien a-t-il fallu d’attentions, de gestes, de présence, de regards, de paroles, de petits mots, d’inventivité, pour nous tirer de là !
II. Le combat pour la sécurité routière.
Pour ce qui est de la sécurité routière et de l’engagement qui a suivi cet accident, disons d’abord que certaines associations nous ont approchés vraiment trop tôt. Nous étions submergés par le fait que, alors que nous étions à ce point dans le besoin, elles viennent nous solliciter pour grossir leurs rangs et nous proposer un secours que nous ne réclamions pas. C’est peu à peu que les questions se sont posées. Le premier signe pour moi – mon mari m’a toujours encouragée dans ce combat, mais je pense qu’il s’en serait passé pour sa part – a été de constater que malgré tant de sympathie autour de nous, nous n’observions pas de sursaut d’indignation devant les circonstances de la mort de nos enfants. L’autre moment de prise de conscience a été le procès, auquel nous ne nous sommes pas rendus, parce que nous avions conscience qu’il s’agissait du procès du prévenu et non pas du nôtre (nous étions bien sûr représentés par un avocat), et parce que j’attendais un bébé, que nous nous sentions en danger de mort à chaque instant et que c’était inutile de prendre le moindre risque de basculer du côté de la tentation de la mort plutôt que de la tentation de la vie. Nous nous sommes épargné notre présence au procès.
Le résultat nous a laissés perplexes, puisque ce jeune homme a été condamné, en francs de l’époque, à 1200 francs pour ceci, à 800 francs pour cela, après avoir été déclaré seul responsable de l’accident. Nous n’attendions pas des peines démesurées, mais nous espérions qu’il ne conduirait plus, pendant un moment, or il est reparti du tribunal au volant de sa voiture. Il nous a semblé que ce jugement était incompréhensible, tant pour lui que pour nous. Ou bien, comme l’avait reconnu le juge, il était responsable et seul responsable de cet accident qui avait provoqué la mort de deux sœurs, et il devait cesser de conduire pendant le temps nécessaire à une maturation, ou bien il n’était pas responsable, et il fallait que cela lui soit dit. Ce jugement nous a paru refléter un désarroi de la justice devant une question qui était à l’époque 50% de fois plus fréquente qu’aujourd’hui, car on déplorait 12000 morts par an et non pas 8000 comme de nos jours.
Enfin, le troisième élément a été que, étant moi-même à l’ époque orthophoniste, éditorialiste à Elle, très curieuse de savoir tout ce qui pouvait m’être utile en tant que mère, ayant eu le sentiment d’avoir fait, pour élever mes enfants, les efforts raisonnables qu’une mère de famille doit faire, j’avais bien conscience que, sur l’intervention de ce jeune homme dans la vie de mes filles, je ne pouvais rien. Qu’aurais-je pu faire, moi, qui ait évité ce résultat ? Deux choses entrent en ligne de compte. L’une est de l’ordre de l’intime : j’avais cédé aux pressions familiales, qui m’avaient convaincue de rendre le billet d’ avion que j’avais initialement réservé pour mes filles et de les laisser partir en voiture. L’autre aspect, c’était la ceinture de sécurité à l’arrière. C’était une époque où les voitures, depuis très peu de temps – or, la voiture de ma belle-sœur était neuve – devaient sortir de l’usine avec deux ceintures de sécurité à l’arrière. Mais je n’avais jamais vu qui que ce soit porter la ceinture de sécurité à l’arrière, et la seule chose que je me souvenais avoir lue était que, pour les enfants, elle était mal adaptée, parce qu’elle passait au niveau de leur artère jugulaire. J’avais donc recommandé à ma belle-sœur de ne pas attacher mes filles. D’où leur éjection et leur mort.
Je me suis donc dirigée vers l’administration de la Sécurité routière, située à ce moment-là avenue Marceau, dans des bureaux vétustes. Le délégué interministériel de l’époque m’a raconté, après, qu’il avait recommandé, me voyant arriver, qu’on me laisse chercher, qu’on m’accorde une aide neutre et bienveillante, sans plus. En fouillant dans ses documents, extraordinairement documentés justement, extraordinairement savants, je suis tombée sur une phrase d’une petite brochure, qui disait quelque chose que je n’ai jamais oublié: »N’importe quelle ceinture de sécurité vaut mieux que pas de ceinture du tout », et j’ai trouvé cette autre indication: « Le passager qui reste à l’intérieur du véhicule a dix fois plus de chances de survivre que celui qui est éjecté ». J’ai su que, si j’avais lu cela où que ce soit, si je l’avais entendu au passage à la télévision ou à la radio, j’aurais demandé que mes enfants soient attachés. Cela a été certainement, non pas le plus grand remords, parce que c’était une information qui n’était nulle part – je l’ai scrupuleusement vérifié par la suite –, mais le plus grand regret.
J’ai donc à partir de ce moment-là consulté les livres que toutes les jeunes mamans achetaient quand elles étaient enceintes, puis jeunes mères, qui étaient J’attends un enfant et J’élève mon enfant, de Laurence Pernoud. J’ai pu vérifier que pas un mot n’était dit sur cette question. J’ai appelé Éliane Victor, qui était directrice de la rédaction de Elle, et qui produisait une émission quotidienne pour les femmes, à la télévision ( Une minute pour les femmes ). À ma demande, involontairement cruelle, elle a fait faire des recherches pour savoir si elle avait déjà dans son émission recommandé aux mères d’attacher leurs enfants à l’arrière et m’a confirmé que ce n’était pas le cas. Dès lors, je me suis dit que l’information n’était pas dans le public, que la justice ne travaillait pas comme elle le devrait, qu’il n’y avait pas d’ opinion publique sur cette question. J’avais aussi découvert que notre pays était particulièrement mauvais dans ses résultats en comparaison de beaucoup d’autres.
Les rencontres jouent toujours aussi un rôle déterminant dans les engagements. Ainsi, j’ai rencontré une jeune femme qui habitait mon quartier et dont la fille, quelques jours avant les miennes, avait été heurtée sur un passage pour piétons en allant au lycée Jean de La Fontaine. Elle était morte. Cette jeune femme et moi-même avons décidé d’agir ensemble, dans une ignorance totale de tout ce qui peut intéresser la presse. Nous étions vraiment naïves et je me souviens de notre première conférence de presse : nous avions appelé tout le monde, enfin, ce qui était tout le monde pour nous. Cela représentait beaucoup de coups de fil, et beaucoup de voix très ennuyées à l’ autre bout du téléphone. Nous avions choisi un café au Châtelet, parce que nous nous étions dit que, pour les journalistes, il fallait un endroit central afin qu’ils ne se dérangent pas trop. Nous sommes restées toutes seules, personne n’ est venu, et nous avons bu un café ensemble…
Je vous raconte ce souvenir pour vous dire qu’il faut être très indifférent à tout, sauf à ce que l’on veut faire. Rien, aucune vexation, aucune déception ne doit vous en détourner. On a besoin d’une énergie folle pour militer, et l’amertume, la rancune sont terriblement consommatrices d’énergie. Il faut s’en détourner farouchement. Ensuite, nous avons décidé que (puisque nous avions tant de succès !) nous allions nous présenter aux élections, parce que l’élection présidentielle est suivie d’élections législatives, après lesquelles viennent toujours des partielles. Nous nous sommes lancées dans les 2è et 3è arrondissements de Paris sur le thème unique de la sécurité routière, et nous n’avons pas eu un résultat si mauvais, avec près de 2% des voix !
À cette époque, en janvier 81, nous avons rejoint une association de familles de victimes. Mais nous ne supportions pas ce milieu. Nous étions encore trop proches de la famille heureuse, des enfants petits. Nous nous sommes senties coupables de nous sentir mal, mais nous n’avions qu’une idée, c’était de quitter cette association. Nous avions aussi le sentiment que les drames de la route, la délinquance routière étaient un scandale de société et dépassaient de loin le sort des familles de victimes. Il était profondément immoral de voir tout cela arriver si souvent, alors que cela nous paraissait si facile à régler et qu’aujourd’hui encore, il suffit de ralentir, de mettre sa ceinture, de ne pas boire, de mettre son casque. Ce n’est rien. Aucune grande cause sanitaire – car c’en est une – ne demande si peu d’efforts pour tant de progrès. Et pourtant, ce n’est pas si facile que cela…
Nous avons donc décidé de fonder la Ligue contre la violence routière, avec pour objectif ( c’est notre objet social ) de lutter par tous les moyens légaux contre l’insécurité routière et ses conséquences. Mais notre idée, c’était qu’il fallait absolument que tous ceux qui auraient voulu savoir sachent, et qu’un sursaut d’opinion soit provoqué afin de contraindre les hommes politiques à faire de la sécurité routière une priorité. Or, la fondation de la Ligue intervient au printemps 83, et ce n’est que le 14 juillet 2002 que le président de la République déclare à la surprise générale, y compris la nôtre, que le premier de ses trois chantiers personnels, c’est la sécurité routière. Cela aura donc pris vingt ans. Bien sûr, il s’est passé beaucoup de choses en vingt ans, mais il reste vrai que, jusqu’en juillet dernier, la sécurité routière n’a jamais été une priorité, sauf pour des individus isolés, ayant parfois des moyens d’agir, mais faibles. Nous sommes maintenant nombreux et nous avons une puissance de nuisance importante. Nous n’avons pas l’intention de laisser passer cet engagement du président de la République sans que des comptes soient demandés à son gouvernement.
Autrefois, en 1973, d’après ce qu’on m’a raconté, quelqu’un d’autre a jugé que la sécurité routière était une priorité, et cette personne, qui avait combattu héroïquement pendant la guerre de 39-45, qui connaissait le prix de la vie, était le Premier ministre, qui ne pouvait pas supporter que, cette année-là, on ramasse 17000 morts sur les routes de France. Et sans aucune demande de la population, alors que lui-même n’avait rien à y gagner, il a voulu qu’on y mette bon ordre. C’était Jacques Chaban-Delmas. Le président de la République d’alors ne s’intéressait nullement à la question. Georges Pompidou était lui-même un conducteur de Porsche, c’était la grande époque de l’ ascension de la voiture, avant le premier choc pétrolier, et Chaban savait que ses propres jours étaient comptés au gouvernement. Il a demandé à son président de créer une délégation interministérielle à la sécurité routière, qui serait rattachée directement à Matignon et qui ainsi pourrait agir avec tous les ministres concernés. Pompidou n’ a pas voulu lui dire non. C’est ainsi que cela s’est fait et que les premières mesures ont été prises. Souvenez-vous, il n’ y avait pas de limitation de vitesse, pas de seuil maximum d’ alcoolémie, le casque n’ était pas obligatoire et la ceinture de sécurité n’existait pas. Je pense qu’aucun d’entre nous ne voudrait retourner à cette époque-là.
Les étapes qui ont suivi ont toutes marqué un avant et un après. La Ligue contre la violence routière a accompagné à peu près tous les progrès. Certains sans doute se seraient accomplis sans elle, mais d’autres non. Les passages ont été extrêmement longs et il a fallu de durs combats pour les obtenir. Mais aujourd’hui, même nos adversaires de l’époque ne voudraient pas revenir en arrière. Je vous donne l’exemple du 1, 2 g. d’alcool au volant, qui était le seuil délictuel quand la Ligue contre la violence routière a été fondée. Aujourd’hui, ce seuil est de 0, 8 g., après un passage à 0, 7, et le taux de contravention est de 0, 5. Je pense que personne ne voudrait revenir à l’époque antérieure, mais nous avons pourtant été pendant un temps les victimes de nombreuses insultes, nous avons subi les cris des viticulteurs et les discours stupides des députés élus dans les départements viticoles.
Une autre mesure m’était, évidemment, particulièrement chère : l’obligation du port de la ceinture à l’arrière. Même si elle est très mal respectée, elle existe, et a été acceptée en douceur. Nous avons su montrer l’ exemple. Je ne suis pas une femme de terrain, mais, heureusement, beaucoup d’autres militants qui ont un rôle central à la Ligue le sont, et certains ont eu l’idée d’un partenariat avec Baby-Relax et les maternités de leur voisinage. Baby-Relax donnait et entretenait des petits lits adaptés à la sécurité des enfants. Ils étaient prêtés aux mamans à la sortie de la maternité. Notre espoir était qu’ayant pris l’habitude d’installer convenablement leur enfant, ces mères ne perdraient jamais cette habitude. Cette mesure a été très populaire, les sociétés d’assurances s’y sont mises, tout le monde a prêté des lits ou des sièges-enfants, si bien que la loi est passée très naturellement. Aujourd’hui, les parents dont l’enfant a été éjecté ou projeté parce qu’il n’était pas attaché sont victimes de leur négligence, pas de leur ignorance, ce qui est tout de même différent. Ils sont aussi victimes de la négligence de l’État, qui ne veille pas à l’observation des textes que le Parlement vote au nom du peuple.
Tout ne se passe pas si facilement. En 1992, lorsque le permis à points allait être présenté à l’ Assemblée Nationale, les transporteurs routiers l’ont mal compris. Le mur de Berlin et le rideau de fer s’étaient l’un écroulé et l’autre levé, et on voyait déferler sur les routes des artisans venus de l’est qui étaient prêts à travailler jour et nuit pour une bouchée de pain, tandis que les transporteurs français étaient soumis à quelques réglementations déjà. Ces derniers ont cru que le permis à points allait les pénaliser, et qu’ ils ne pourraient plus gagner leur vie. Ils ont bloqué les routes de France pendant très longtemps. J’ai été absolument stupéfaite devant l’inertie de l’opinion publique, qui leur était favorable. C’était début juillet, personne ne pouvait partir en vacances, on ne pouvait pas aller travailler…La liberté d’aller et de venir n’est-elle pourtant pas un bien précieux ? Néanmoins on leur portait à boire et à manger, il y avait même des prostituées qui venaient pour égayer l’austérité de leur temps de grève.
En France, tout le monde se moquait du problème, parce que l’attention des gens, ou du moins de la presse, se concentrait sur le voyage du président de la République à Sarajevo. Quasiment chaque jour – j’étais journaliste à La Croix, à cette époque – le journal télévisé m’invitait au 20 heures pour essayer de débloquer la situation. J’étais furieuse et je disais aux grévistes : » Mais rentrez chez vous, vos femmes vous attendent, la route ne vous appartient pas, vous n’avez pas mieux à faire ? Retournez auprès de vos enfants ! » Et, quand je rentrais à La Croix, on me reprochait mon manque de considération pour des gens dans l’ennui. Il fallait, me disait-on, entendre leurs revendications.
Finalement j’ai demandé rendez-vous, au nom de mon association, à François Mitterrand et il m’ a reçue pendant trois-quarts d’heure. Ce jour-là, il atterrissait en hélicoptère de Sarajevo et savait à peine qu’une grève des camionneurs gênait tout le monde depuis des semaines. Lorsque je lui ai dit pourquoi j’avais sollicité cet entretien, il est allé prendre connaissance des gros titres du Monde, qui était posé sur son bureau. Il y était question de la grève des camionneurs et c’est alors que je me suis dit qu’il fallait en effet écouter leurs doléances, partir de là pour avancer. J’ai parlé au Président de leurs conditions de travail et de leurs conditions de concurrence, qui étaient les unes comme les autres insupportables, et j’ai pensé qu’il fallait leur dire que ce problème allait être débattu et que par ailleurs le permis à points n’était pas là pour les gêner, mais pour sauver des vies, dont les leurs.
À la sortie de cet entretien, sur le perron de l’Elysée, sont venues me questionner les agences de presse, que je ne m’attendais pas à voir. Je me retrouve donc avec Reuter et l’A.F.P. qui me tendent leurs micros et me demandent ce que m’a dit le président de la République. Je flotte un instant et je leur réponds, ce qui était vrai : « Le président de la République m’ a dit que les camionneurs étaient les serfs de notre époque « . Puis j’ose, je me lance et leur affirme : » Le président de la République nous a aussi promis qu’il ne reculerait pas d’un pouce sur le permis à points ». J’ai pensé qu’il ne pourrait pas démentir ces paroles. Donc le lendemain, manchette : « Les camionneurs sont les serfs de notre époque. Le président de la République ne reculera pas d’ un pouce sur le permis à points ».
Ensuite Monsieur Beregovoy, Premier ministre, me téléphone et veut me voir. Cela me fait plaisir de raconter cela, parce qu’on lui doit là quelque chose qui n’a pas été porté à son crédit après sa mort. Il me dit : « Mon gouvernement va probablement tomber sur cette grève. Ce n’est pas grave (il savait que, de toute façon, il en avait pour peu de temps, et que la droite allait remporter les élections suivantes ), mais je serai remplacé par un nouveau Premier ministre qui n’aura qu’une idée, c’est de se débarrasser du permis à points, pour pouvoir remettre les compteurs à zéro et repartir sur de bonnes bases. Est-ce que je peux aménager le permis pour les chauffeurs routiers ? » Je lui réponds : « Monsieur, je ne suis pas là pour vous dire que vous pouvez aménager le permis. Si vous le faites, je me répandrai dans toute la presse en disant que vous avez abandonné les victimes de demain à leur triste sort « . Il m’a dit que dans ces conditions il ne pouvait pas le faire. Le lendemain, il annonce que le texte est présenté à l’Assemblée tel quel. Les camionneurs lèvent leur siège, le permis à points est adopté et tout le monde peut partir en vacances .
Dans l’année qui a suivi l’adoption du permis à points, le nombre de morts a diminué, et ces vies-là sont gagnées une fois pour toutes. Ensuite, dans l’inertie, depuis 1994, les chiffres stagnent. Ils stagnent chez nous plus que chez nos voisins. L’Angleterre qui avait déjà deux fois moins de morts que nous quand nous avons fondé la Ligue, en a aujourd’hui moins de deux fois moins. Et je dirai que les progrès, vraiment infimes depuis 1994, se sont faits presque malgré nous, non pas malgré nous membres de la Ligue, mais malgré nous Français. Cela a suivi une espèce de mouvement général de diminution, mais des pays qui étaient moins bons que nous sont devenus meilleurs entre-temps, et seuls ont de plus mauvais résultats deux pays dont le niveau de développement et d’industrialisation n’est pas comparable au nôtre, la Grèce et le Portugal.
Pourquoi restons-nous à pied d’œuvre, à la Ligue ? Je pense que chacun d’entre nous aurait sa réponse, et nous sommes maintenant plusieurs milliers d’adhérents. Pour ma part, je me sentirai quitte quand mon pays aura rejoint les pays décents dans ce domaine. Je ne peux pas admettre qu’en étant dotés de législations tout à fait comparables, des mêmes moyens financiers, et en ayant davantage de policiers par habitant, nous laissions mourir sur la route deux fois plus de gens que les Anglais, et que nos enfants paient un tel prix à cette violence particulière. Je sais que la responsabilité de chacun est entière au volant. Nous n’ avons jamais cherché à diminuer la part de libre-arbitre de chacun dans ce domaine, mais nous savons que les rappels à la loi sont indispensables, qu’ils sont la base de toute éducation. Et tant que pour deux jeunes qui meurent chez nous, il n’y en a qu’un en Angleterre, tant que je peux lire dans le journal qu’à Paris, sur dix petits coursiers, un sera accidenté dans l’année, alors que ce n’est pas vrai chez nos voisins, tant que l’on ne pourra pas supposer qu’on est arrivé à un chiffre difficilement compressible, en constatant que les autres pays n’ont pas trouvé de solution meilleure que la nôtre, tant aussi que nous aurons une quelconque crédibilité à parler de ces questions (parce que cela s’use aussi), je pense que ce qu’on appelle pompeusement les cadres de la Ligue resteront fidèles au poste.
Téléchargez le pdf