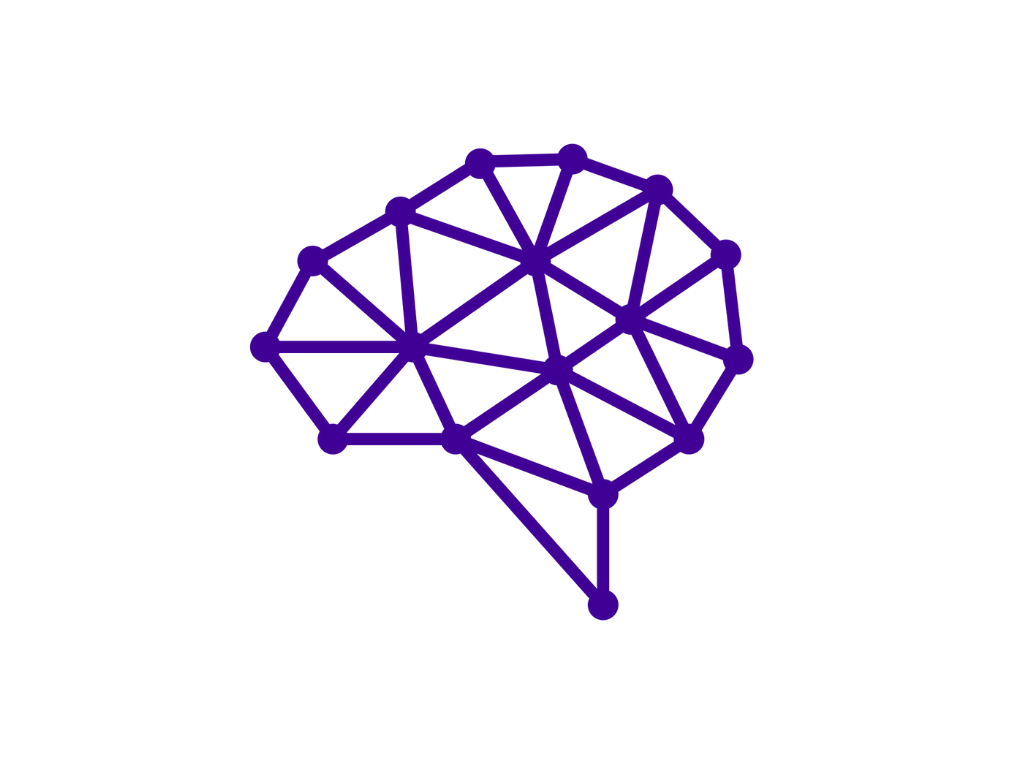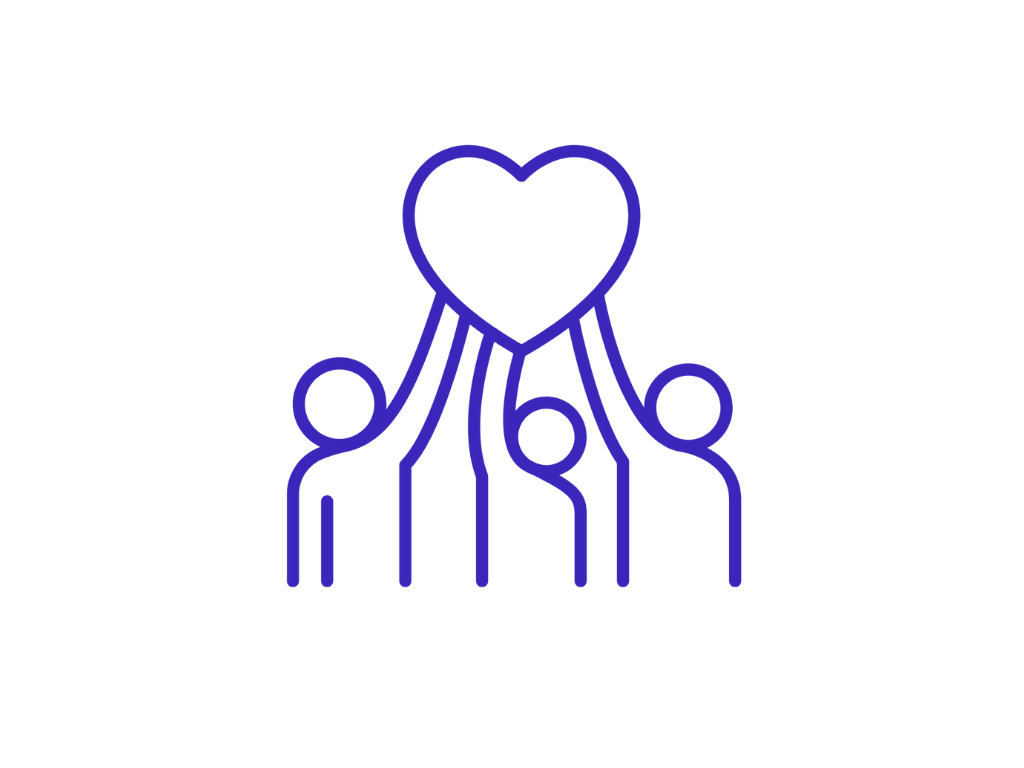Conférence donnée lors de la session 1999 des Semaines sociales de France, « D’un siècle à l’autre, l’Evangile, les chrétiens et les enjeux de société »
Joseph MAÏLA, doyen de la faculté des sciences sociales et économiques de l’Institut catholique de Paris
Il y a dix ans, presque mois pour mois, survenait un événement qui allait bouleverser les rapports internationaux tout comme notre perception du monde : la chute du mur de Berlin, en 1989, donnait libre cours à une série de questions concernant le devenir de nos sociétés, des États et de la sécurité dans un monde en recomposition.
On assistait en outre à une éclosion de mythes consensuels annonçant la prétendue fin d’une ère. Nous en relèverons trois : le mythe du consensus politique succédant à la fin des idéologies et à l’issue de la guerre froide, l’histoire s’achevant avec la disparition des conflits. Le mythe économique du libre marché comme projet universel né sur les cendres de l’utopie communiste. Un troisième mythe allait faire florès : celui du consensus sur les valeurs. La philosophie politique des droits de l’homme semblait devoir l’emporter sur les idéologies totalitaires et triompher de toutes celles à venir.
On croyait donc, à ce moment-là, les racines de tout conflit d’envergure arrachées, la rationalité du marché avérée, et la rationalisation des valeurs possible. Cette espérance s’est très vite effondrée devant une montée insoupçonnée des violences ; la décennie dont nous vivons la fin a été la plus meurtrière depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle s’est effondrée aussi devant les désordres économiques, dus aux crises mexicaine, russe, asiatique… Elle s’est heur-tee enfin à la montée des résistances à ce que j’appellerai un « ordre culturel mondial », perçu comme un ordre culturel occidental.
Par-là même, après avoir mis tous nos espoirs dans la mondiali3ation, nous avons tendance aujourd’hui à la rendre responsable de tous nos maux, sans réaliser que nombre de déséquilibres qu’on lui préexistent à son avènement. Certains d’entre eux, en germe dans la construction de nouveaux États après la Seconde Guerre mondiale et la décolonisation, notamment dans les pays du tiers-monde, étaient probablement maintenus artificiellement à l’état latent par la guerre froide. Quant au libéralisme économique, il remonte bien avant que la mondialisation ne s’impose. Pour ce qui est du conflit autour des valeurs, il n’avait pas attendu que le mur-de Berlin s’effondre pour se déclarer ; l’islamisme en est une preuve parmi d’autres.
La mondialisation ne me semble donc pas une source de dangers-plus abondante qu’une autre pour l’avenir. En revanche, les risques qui lui sont liés sont moins visibles parce qu’elle contracte formidablement l’espace, grâce aux transports modernes, et le temps, grâce à l’information en temps réel et aux nouveaux moyens de« communication ; parce qu’elle annule les frontières en décloisonnant les marchés, en réduisant la souveraineté des États et en ouvrant les barrières douanières. Il n’y a plus désormais de ligne Maginot qui puisse dessiner les contours d’un sanctuaire derrière lequel la sécurité des États puisse être assurée.
1. Le risque économique
Aujourd’hui, la philosophie dominante, sur le plan international et en matière économique, est celle du libre-échange, de la libre concurrence, de la dérégulation, philosophie que n’épousent pas avec un même enthousiasme les pays du Nord et ceux du Sud… Même au sein des nations riches, elle fait l’objet de débats houleux : les récentes négociations à l’OMC le prouvent.
Trois contradictions fondamentales battent en brèche ce dogme, Première contradiction les inégalités augmentent. Des zones de prospérité, concentrant production et consommation, s’étendent autour de l’Amérique du Nord, avec l’ALENA, de l’Europe, avec la perspective de l’Union européenne, et du Japon. L’Europe et les Etats-Unis, qui représentent 13 % de la population du globe, concentrent à eux seuls 44 % du PIB mondial. Si l’on ajoute les 10 % de la population du sud-est asiatique, on parvient à la proportion de 23 % de la population mondiale réalisant 80 % du PIB monétaire international. De son côté, l’Afrique sub-saharienne, qui constitué 7 % de la population mondiale ne contribue que pour 2,3 % au PIB. Tout comme le Rio Grande est une frontière entre les États-Unis et le Mexique, la Méditerranée est une frontière entre un monde abandonné aux séductions du libre marché et recroquevillé sur ses privilèges, qui concentre à lui seul la consommation privée, et un monde voué à la paupérisation. 20 % des habitants des pays les plus riches du monde accaparent ou assurent 86 % de la consommation mondiale tandis que 20 % des habitants des pays les plus pauvres du monde n’assurent que 1,6 % de cette consommation.
La deuxième contradiction concerne la dette des pays les plus pauvres. En vingt ans, celle-ci a quadruplé. Elle se monte aujourd’hui à 2 450 000 000 de dollars ! Rien n’indique que ce chiffré énorme doit baisser. Au contraire, car cette dette est structurelle; en vertu d’une loi qui semble pour le moment intangible, qui fait que la croissance augmente dans les pays les plus pauvres, mais au rythme de 1,5 % par an, tandis que la croissance démographique, elle, augmente au rythme de 4 % par an.
Il est vrai que le FMI et le G 7 ont fait un effort considérable pour alléger la dette des États les plus faibles de la planète, des PPTE, les 41 « pays pauvres très endettés » dont le ratio de la dette à l’exportation est de 243 %. Mais, bien que le pape Jean-Paul II en ait exprimé le souhait lors de la proclamation de l’année jubilaire, le FMI ne l’a pas effacée. Il a opté pour un plan progressif, estimant qu’une remise de dette pure et simple serait contre-productive. Une dizaine de pays bénéficient de ce plan de réajustement. Le G 7 n’est pas en reste: lors des conférences qui se sont succédé, à Toronto, à Naples, à Lyon, mais surtout à Cologne, il s’est prononcé en faveur d’un allégement de la dette allant, pour certains pays, jusqu’à une remise de 90 %.
Troisième contradiction : la concentration des richesses. On estime aujourd’hui que les cent premières entreprises transnationales du monde pèsent 1 800 milliards de dollars en capitaux, pour un chiffre d’affaires de 2 100 millions de dollars, c’est-à-dire une fois et demi le PIB de la France ! Elles assurent 27 % de la production mondiale à elles seules, et investissent 650 milliards de dollars chaque année dans les pays. Mais il faut savoir que 75 % de ces investissements échoient aux pays du Nord et le reste aux pays en voie de développement, avec 1,3 % d’investissement uniquement en Afrique, le continent délaissé de la mondialisation.
Je voudrais maintenant dégager les dysfonctionnements importants dans le fonctionnement de l’économie internationale. J’en relèverai une fois de plus trois.
Le premier tient à la spéculation boursière, à un capital devenu autonome par rapport au travail et qui s’investit où il veut, quand il veut, sur les terrains où les plus-values sont les plus importantes. Servant au plus près les intérêts de son ou de ses détenteurs, il investit des secteurs clés de la production et se retire sans crier gare lorsque les cours baissent, indifférent au vide qu’il laisse derrière lui et à ses conséquences dramatiques dans certains pays où les économies sont fragiles.
La crise du Mexique a été significative à cet égard et a attiré pour première fois l’attention du inonde sur les méfaits potentiels de la libre circulation des capitaux. La crise asiatique aussi a été révélatrice des dangers que représentent le manque de maîtrise des institutions financières et la faible surveillance des capitaux, notamment des capitaux à court terme ; lorsque les grands pôles de production coréens se sont endettés jusqu’à hauteur de 300 % de leurs fonds propres — une somme énorme que ne se serait jamais autorisé un pays du Nord —, la situation est devenue incontrôlable, même avec le secours des grandes instances financières internationales.
Contrôler les capitaux à court terme en taxant les transactions financières est une idée qui prend corps. En témoigne le succès sur le plan international d’actions comme celles menées par ATTAC (Association pour une taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens). Mais on sait que cette taxation se monterait à un montant infime par rapport à l’ampleur des bénéfices qui sont réalisés.
Le deuxième dysfonctionnement se traduit par ce que j’appellerai « la perversion des échanges économiques ». La mondialisation ne va pas seulement dans le sens d’une meilleure productivité, d’une meilleure production, d’une libre concurrence. Elle va aussi dans le sens d’un détournement du capitalisme à des fins commerciales illégales la drogue, le blanchiment de l’argent, l’exploitation des filières de l’immigration… Dans le contexte de l’économie mondialisée, parce que les frontières s’effondrent, que des États se disloquent, des pays de l’Est à l’Afrique… ces activités ont de beaux jouis devant elles. Elles prospèrent de telle sorte que le FMI estimait plus de 2 000 milliards de dollars, sur la dizaine d’années écoulée, les bénéfices engendrés par toutes sortes de trafics.
Gérer collectivement un risque comme celui-ci en. période. de mondialisation pose problème, parce que les filières ou les organisations criminelles se sont adaptées elles-mêmes à la mondialisation. Les luttes entreprises contre Cosa Nostra, contre la mafia, contre les triades chinoises, contre la camora napolitaine, contre le cartel de Cali… ont eu des résultats inégaux et ont abouti dans certains cas à un éclatement des réseaux, à leur nucléarisation, rendant la situation encore plus incontrôlable.
En outre, une pratique se répand : celle des « vendeurs de demi-gros », venus des pays du tiers-monde (Nigérians…) ou de l’Est (Tchétchènes, Kosovars…), qui écoulent des quantités moyennes de drogue — 1 à 20 kg — de ville en ville. Ce nomadisme des petits trafiquants achève de compliquer la situation.
Cette évolution du trafic des stupéfiants oblige les États à repenser la lutte et à envisager l’abandon de certaines prérogatives pour mettre en place une collaboration transfrontières. C’est cette tendance qui se dessine dans des accords comme ceux de Schengen.
Le silence, imposé par la loi, qui entoure certaines pratiques financières doit être aussi mis en cause. Le blanchiment de l’argent sale est une activité qui représente près de 300 milliards de dollars par an. Des institutions comme l’OCDE commencent à s’en alarmer, qui ont créé un comité pour lutter contre cette pratique et qui plaident pour la limitation du secret bancaire afin de faciliter l’action des policiers.
Il faudrait encore parler de la corruption, véritable fléau des économies des pays pauvres ou en voie de développement, qui sape les fondements des fragiles expériences démocratiques menées dans certains d’entre eux.
Un troisième dysfonctionnement dans l’économie mondialisée tient au risque écologique. Celui-ci est aujourd’hui devenu un risque planétaire tel que le « développement durable » l’expression a été lancée par le rapport Bruntland en 1988 — est passé de l’état de concept à celui de priorité pour tous les pays. Il s’agit aujourd’hui de produire en sauvegardant, et en essayant de transmettre — tout le monde s’accorde sur le principe — aux générations qui viennent, une terre qui soit encore un habitat viable.
Ce programme est extrêmement séduisant, mais la gestion collective de ce risque se heurte à des difficultés considérables. Le problème-est que, là encore, le risque écologique est source d’inégalités. Polluer moins, cela signifie produire mieux, cela signifie produire plus propre, cela signifie produire plus cher. Tout le monde n’est pas en mesure de dégager les investissements nécessaires à la mise en place de systèmes de dépollution. En outre, chacun ne pollue pas de la même manière ni dans la même proportion.
La conférence de Rio n’est plus qu’un lointain souvenir. Quant à la conférence de Kyoto, en 1998, elle a abouti à un consensus sur la nécessité de limiter, à concurrence de moins 5 % sur une période de dix ans, les émissions de certains gaz toxiques et destructeurs d’ozone dans l’atmosphère. Mais ni les USA ni l’Union européenne n’ont ratifié ce protocole. De plus, certains pays, dont les États-Unis, ont proposé d’acheter des droits de polluer à des pays moins productifs !… À Buenos Aires, en 1998, échec aussi de la mise en place des mesures nécessaires pour avoir une chance de conserver une nature « pourvoyeuse de biens », selon l’expression de Jean XXIII.
Des espoirs cependant se font jour. L’écologie et la protection de l’environnement ont été récemment enfin inscrites au programme de l’Organisation mondiale du commerce. Lors d’un débat à l’Uruguay Round il a été décidé que : premièrement, l’environnement faisait désormais partie des négociations du millénaire ; deuxièmement, il est admis que les règles de la réciprocité ne seront pas automatiquement appliquées en mesure d’écologie ; troisièmement, les subventions étatiques à la lutte contre la pollution suant désormais admises, sans être suspectées d’être des subventions indirectes à la production.
Des mesures donc se mettent progressivement en place… pendant que nous continuons chaque année d’envoyer dans l’atmosphère 7 milliards de tonnes de gaz carbonique et d’accumuler 12 milliards de tonnes de déchets.
2. Les risques pour la sécurité internationale
Il y a aujourd’hui trois sources principales de menaces pour la.: sécurité internationale. Celle que représentent les guerres de. conquête territoriale, notamment dans les pays du Sud, celle que: fait planer le terrorisme et celle des conflits intranationaux.
À titre indicatif, nous sommes passés d’une trentaine d’États dans les années quarante, à 51 en 1945 et à… 188 aujourd’hui. Si beaucoup d’entre eux ont toutes les apparences d’un État (une armée, un gouvernement, une administration, une police…), ils n’en ont pas la culture, et ils se reconnaissent dans des frontières souvent arbitrairement tracées. Entre les pays de l’OUA, l’Organisation de l’unité africaine,-. entre la Chine et Taïwan, entre les deux Corées, entre l’Inde et le Pakistan sur le Cachemire, entre la Grèce et la Turquie sur les îlots de la mer Égée, entre l’Équateur et le Pérou, entre la Russie et l’Ukraine, entre de nombreux États du Moyen-Orient.., se déroulent autant de conflits interétatiques qui n’ont pas fini de se laver dans le sang.
Quant à la menace terroriste, elle constitue un danger d’autant plus grand qu’elle est aujourd’hui diffuse. Pendant longtemps, des groupes terroristes pouvaient se cacher derrière les États et la communauté internationale pouvait désigner des responsables. Ils se …sont mis aujourd’hui à l’heure de la délocalisation, de la décentralisation et de la mondialisation. La dernière attaque spectaculaire lancée en 1998 contre les ambassades des États-Unis en Tanzanie et au Kenya a été orchestrée par un leader islamiste, Ben Laden, installé en Afghanistan et exécutée par des ressortissants soudanais et égyptiens, sans l’appui, du moins en apparence, d’un gouvernement officiel.
Le terrorisme – les spécialistes des affaires militaires font parfois preuve de cynisme quand ils avancent des chiffres – n’aurait fait « que » 10 000 morts en vingt ans. C’est certes négligeable par rapport aux massacres perpétrés lors d’une épuration ethnique, mais, outre que ces morts sont inacceptables humainement, les groupuscules terroristes, bien qu’opérant avec des moyens rudimentaires, économiques, sont susceptibles de compromettre la stabilité d’États entiers.
• Téléchargez le pdf