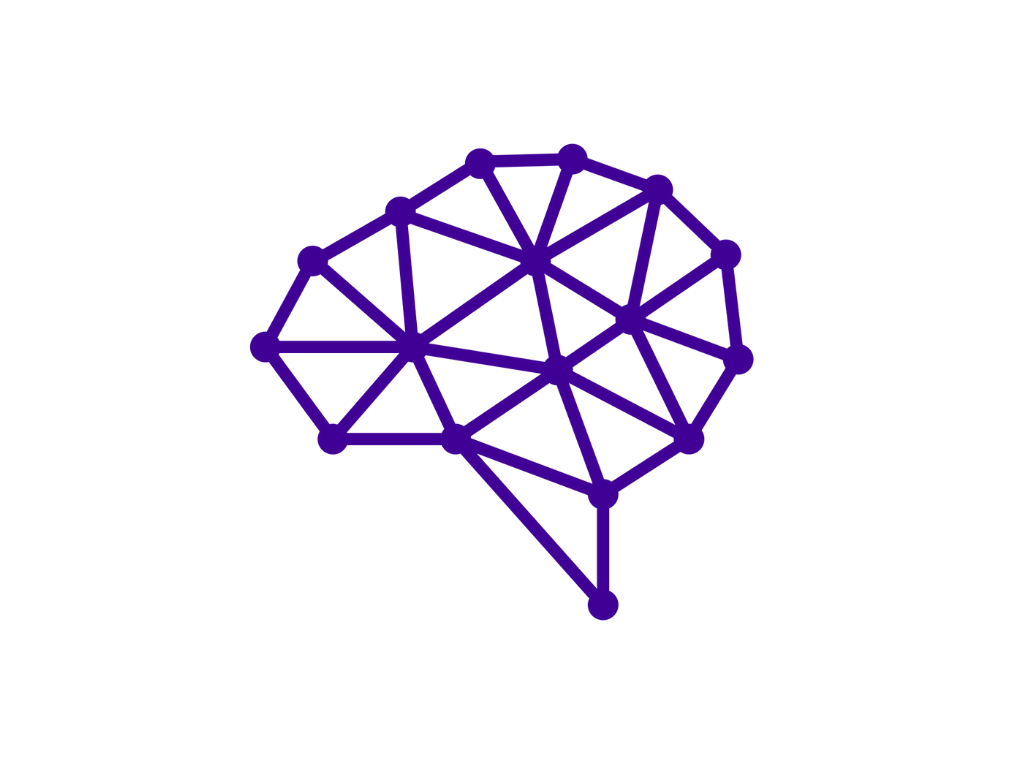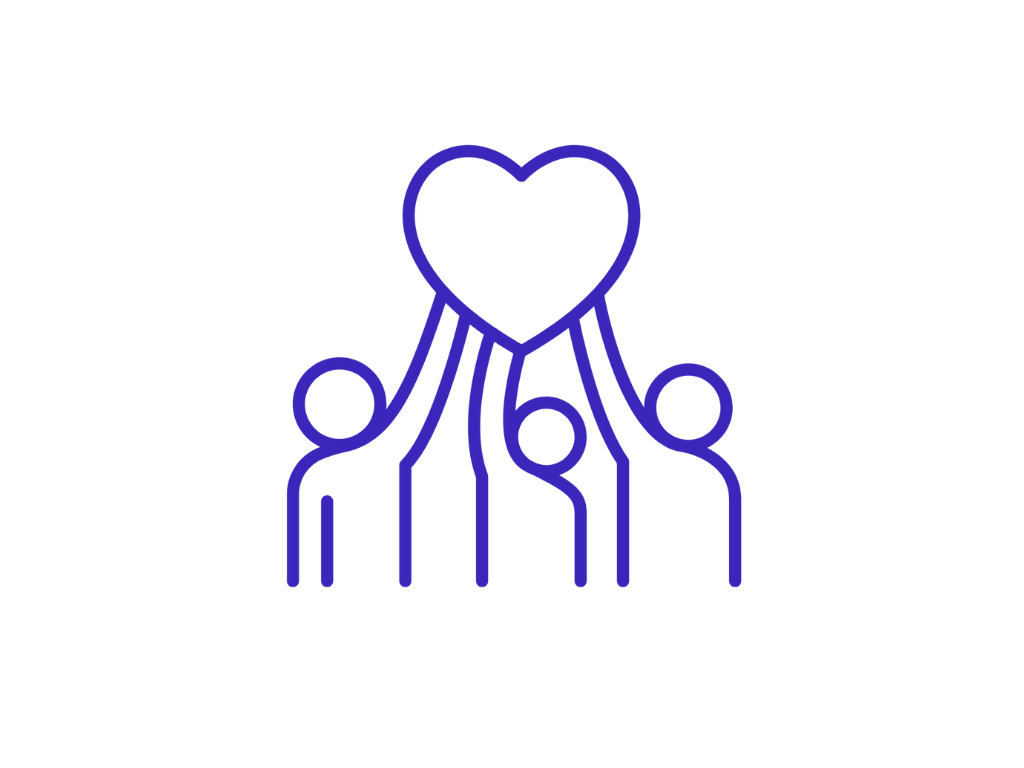Conférence donnée lors de la session 1999 des Semaines sociales de France, « D’un siècle à l’autre, l’Evangile, les chrétiens et les enjeux de société »
Andréa Riccardi, historien, fondateur de la communauté Sant’Egidio
L’invitation de M. Boissonnat à prendre la parole à l’occasion de cette session des Semaines sociales m’a honoré, mais aussi quelque :peu embarrassé je suis historien et j’estime qu’il est difficile de parler au nom de tous à partir de soi-même; à moins d’être rentré dans une phase de narcissisme nébuleux, et j’espère que ce n’est pas mon cas.
Cette invitation m’a aussi obligé à revenir sur le chemin parcouru. Je vais bientôt avoir cinquante ans. Je suis né au début de 1950, année du Jubilée où Pie XII proclama le « grand retour » ; c’était le temps où commençait à émerger l’idée de l’Église comme mission en Europe, à partir de la Mission de Paris et de France. À Rome, on était attentif à ce que, l’on nommait alors la fiiria francese, la fureur française ».
Mais si j’ai, en définitive, accepté avec joie la proposition de M. Boissonnat, c’est parce que je suis heureux de m’adresser à vous ici, à Paris. J’ai une dette intellectuelle et personnelle envers le catholicisme français et envers cette ville où j’ai étudié. Je suis convaincu que, entre le XIXe et le XXe siècle, Paris et la France ont été LE laboratoire où s’est opérée la fusion entre l’Église catholique et la modernité. Cependant, mon milieu d’origine, c’est Rome, où j’ai vécu la plus grande partie de ma vie, dans cette ville où provincial et universel se mélangent.
Au début, ma Rome à moi se limitait à celle de la bourgeoisie : une famille plutôt laïque plongeant ses racines dans le christianisme des générations précédentes, un lycée de jeunes bourgeois, la faculté de droit… Tout à coup, ma génération fut secouée dans sa quiétude par une tornade: le mouvement de Mai 68 fut non seulement italien mais occidental, voire mondial. Les jeunes firent soudain irruption sur la scène politique et sociale, et ce fut le temps de la révolte contre la famille, contre l’école, contre l’Église, contre les institutions traditionnelles. Ce fut le temps aussi des idées politiques plus ou moins utopiques, pour la plupart vouées à l’échec, mais dont certaines eurent malheureusement des corollaires tragiques comme celui du terrorisme (du moins, dans notre pays, avec les Brigades rouges). Ce fut le temps enfin d’un changement anthropologique qui mit au grand jour la crise des modèles classiques.
C’est en ce printemps de 1968 précisément que commence notre expérience de la Communauté Sant’Egidio, parallèlement à celles de nombreux autres rassemblements au sein de la jeunesse en pleine effervescence de l’époque. Dans un climat fortement idéologisé commence alors pour moi la découverte du Nouveau Testament, de son message sur la personne de Jésus et sur ma vie, découverte qui trouve bientôt son prolongement dans celle de la Parole de Dieu. La lecture curieuse et passionnée des Écritures s’est transformée en écoute et en prière. De cette transformation intérieure est née spontanément l’idée de la traduire dans la réalité en fondant une petite communauté autour de l’Évangile, afin de se pénétrer de son enseignement et d’essayer de le vivre, conformément au psaume 119 : « Une lampe sur mes pas, ta Parole, une lumière sur ma route. » Nous étions dès lors animés d’un grand désir de sortir de nos milieux limités et d’ouvrir les yeux sur le chemin que nous avions emprunté jusqu’à présent d’un pas rapide, insouciants, sans prêter attention à ceux que nous croisions. Et ce désir, né il y a bientôt trente ans, loin de s’émousser, ne cesse de grandir…
Des années soixante aux années soixante-dix, notre petite communauté découvrait l’autre Rome, non pas la ville sacrée, les milieux bourgeois, les palais du pouvoir politique, mais le monde des pauvres. A cette époque, l’ex-cité impériale avait des accents de ville du tiers-monde : cinquante mille personnes vivaient dans des bidonvilles, des dizaines de milliers d’autres dans des habitations inadaptées et déconnectées du tissu urbain. Il s’agissait souvent d’immigrés en provenance du Sud du pays. En ce temps, l’immigré avait le visage du paysan du Midi et non celui de l’étranger, comme c’est le cas aujourd’hui. Au sein de ce monde, on sentait que la justice, les chances, pour les petits, d’accéder à l’école, la dignité des femmes… étaient des valeurs bien abstraites. Et l’Église, pourtant omniprésente, n’agissait pas, car la vie religieuse s’était réduite à la dévotion au saint patron du village d’origine ou à la Vierge sur lesquels on comptait pour guérir tous les maux.
Avec mes compagnons, nous avons donc commencé à rencontrer le monde souffrant des pauvres, à travailler avec ces derniers, mais aussi à rêver d’une Église pour eux, d’un Évangile qui leur soit accessible. C’est le rêve de toute communauté chrétienne qui naît parmi les pauvres, en ce milieu violent des bidonvilles, parmi ces femmes et ces enfants, car si l’Évangile ne leur parle pas, à qui parlerait-il ? C’était le rêve d’une Église de tous, mais particulièrement des’ pauvres, cette Église dont Jean XXIII avait parlé au début du concile Vatican II.
Dès lors les pauvres, les « exclus » — une expression moderne pour une catégorie sociale ancienne — sont devenus et demeurent nos compagnons de route. Parmi eux, les vieux, à qui notre société prolonge la vie, mais à qui elle en enlève en même temps en les jetant dans la marginalisation qui tue et en les priant de ne pas s’« éterniser », les malades (en prononçant leur nom, je songe à la mauvaise assistance sanitaire, aux effets du sida, aux handicapés physiques et mentaux…). Mais aussi les Tziganes, un peuple européen qui n’a jamais eu la force ou la fantaisie de s’affirmer comme nation et se retrouve écrasé par toutes les nations (à cause de cela et malgré la tragédie du Kosovo, on ne les considère pas en Italie comme des réfugiés mais comme des clandestins…), les nouveaux pauvres des années quatre-vingt-dix, les SDF (sans-domicile-fixe)…
Les plus démunis changent de visage et d’identité, mais tant qu’ils ne changeront pas de condition, nous resterons avec eux. Les pauvres sont les maîtres silencieux de notre vie et nous protègent des vanités de la société de consommation, des exaltations faciles et des petits plaisirs individuels, tout comme ces vieux, au crépuscule de leur vie, fatigués de courir après un temps qu’ils ne rattraperont plus, et un peu abandonnés par une Église en quête de jeunes.
Gaspille-t-on notre temps avec ceux-là que les médias n’intéressent pas et qui ne sont plus l’avenir de l’homme ? Certes non ! Avec eux nous avons commencé, avec eux nous poursuivons, pas seulement à Rome mais en Europe et dans le monde, notre lutte contre la misère et l’exclusion. Ces pauvres, nous les considérons comme nos amis et nos parents, c’est un trait de notre spiritualité et de notre vie. En eux, nous reconnaissons Jésus.
La relation personnelle que nous entretenons avec eux est déterminante. Chacun représente pour nous rien moins qu’un parent, un .père, un fière, un ami en difficulté. Les pauvres ne sont pas pour nous que des individus à problèmes, ils ont un visage, une histoire personnelle… L’inutilité du choix pour eux est révélatrice d’un des aspects de la marginalité du christianisme, réduit à l’examen sévère de l’utilitarisme contemporain. Dans une Rome effarée par la perte de sa puissance, Grégoire le Grand prêchait : « Chaque jour nous trouvons Lazare si nous le cherchons, et aussi sans le chercher chaque jour nous tombons sur lui. Les pauvres se présentent à nous en nous gênant aussi, ils demandent… ne gaspillez donc pas le temps de la miséricorde. »
Des années soixante-dix aux années quatre-vingt-dix, nous sommes allés à la rencontre d’autres pauvres : ceux de Guinée Bissau, où nous avons fondé un hôpital, ceux du Mozambique, frappés par la guerre et le sida (nous sommes en train de réaliser avec Luc Montagnier un programme pour le traitement du sida, parce que les Africains aussi ont droit aux soins). Depuis les années quatre-vingt, des communautés et des antennes de Sant’Egidio sont présentes dans plus de trente-cinq pays. Elles sont toujours animées par des gens du lieu, en communion avec leurs compatriotes et inscrits dans la réalité locale. Toutes nos communautés se retrouvent amies des pauvres et rassemblées dans la prière du soir autour de la Parole de Dieu.
À Rome, ceux qui le peuvent se retrouvent ensemble, au milieu d’un nombre croissant d’amis, de fidèles qui sont venus un jour, par hasard, et qui sont restés, dans la belle basilique romaine de Santa Maria au Trastevere, non loin d’une cantine pour les pauvres et d’un foyer pour malades du sida, en symbiose avec un quartier ancien et populaire. Mais vous nous trouverez aussi dans un barrir; de’ Maputo au Mozambique, à La Havane à Cuba, dans une chapelle à San Salvador, dans une salle provisoire à Conakry en Guinée, à Barcelone dans le quartier historique, à Kiev et dans de nombreux autres lieux. Ce sont des communautés différentes, mais qui ont toutes en commun l’écoute de la Parole de Dieu et qui, toutes, font de cette dernière le cœur de leur expérience.
Je me souviens que, pendant les années soixante-dix, les visiteurs du Nord de l’Europe posaient toujours la même question : Sant’Egidio est-il un payer group ou un action group ? En France, on me demande souvent quel type de modèle nous inspire. Je suis allergique aux modèles, peut-être en tant qu’Italien, car il y a une chose dont je suis certain c’est qu’aucune expérience ne doit se poser en modèle à l’Église, comme par une espèce de messianisme de groupe qui classerait les chrétiens en première ou seconde catégorie. Nous avons pu prétendre, dans notre communauté, être l’avenir de l’Église… Péché de jeunesse ! Un peu de présomption quand on est adolescents, c’est excusable, mais ensuite au fil des années cela frise le ridicule.
• Téléchargez le pdf