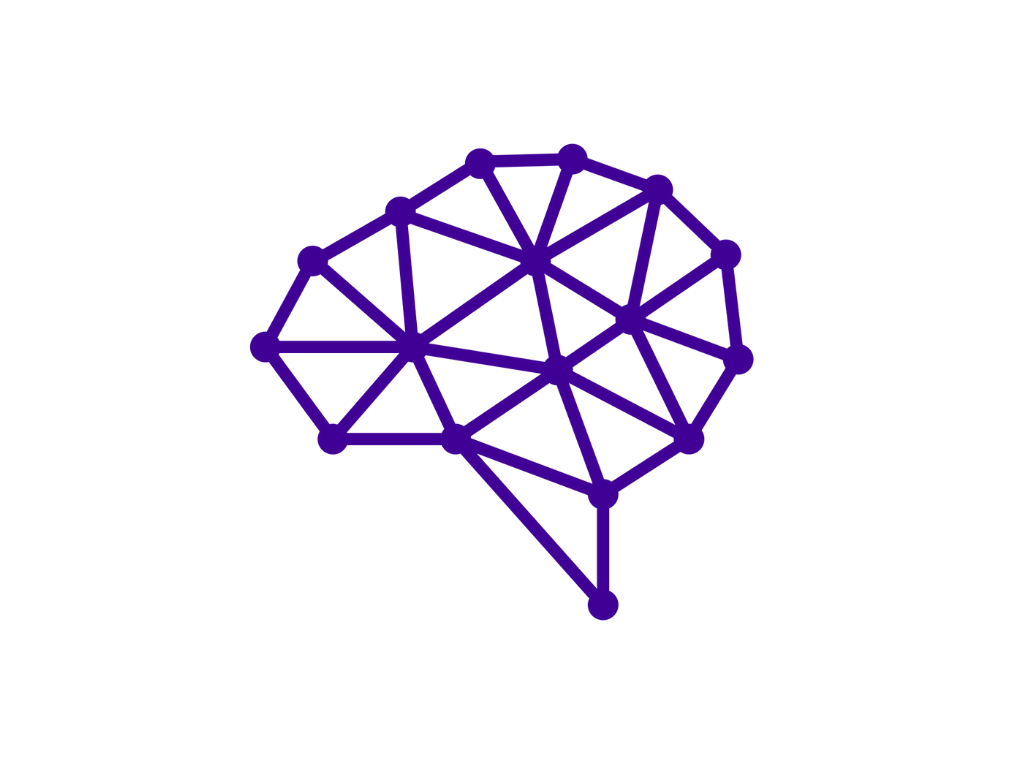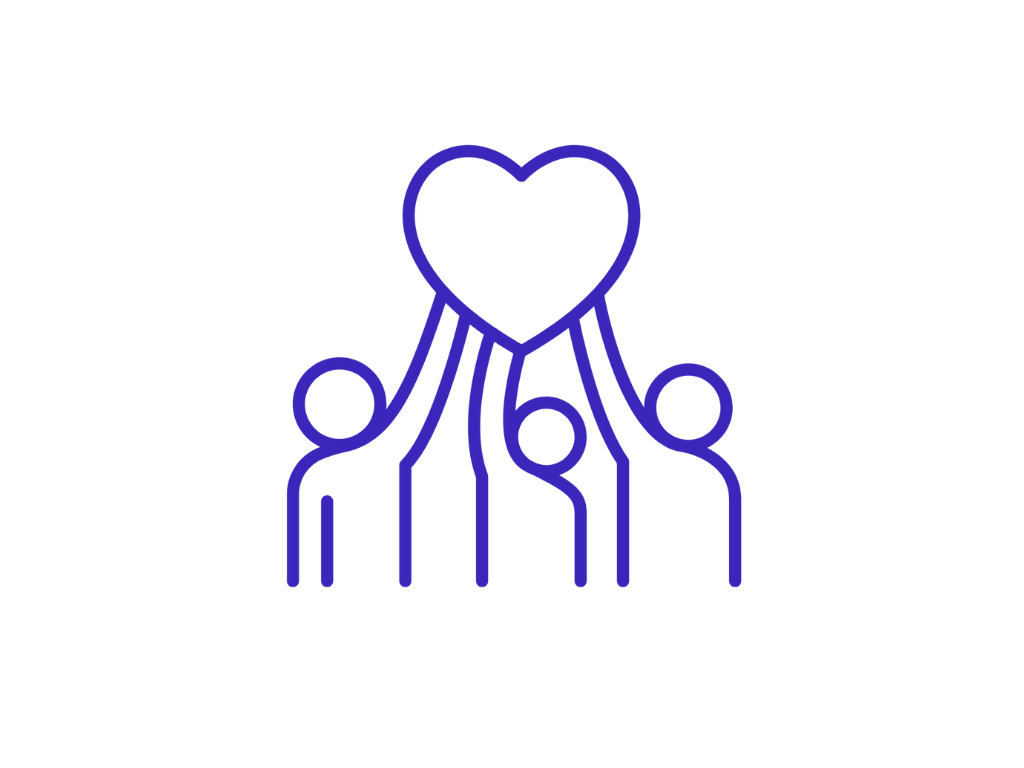Mettre la personne au cœur de la révolution scientifique
L’explosion des savoirs est, pour l’essentiel, à l’origine du phénomène actuel de la mondialisation. Elle a apporté d’immenses bienfaits à l’humanité : santé et longévité, communications et gestion de l’information, transports, production d’énergie, agriculture… La science permet aujourd’hui de répondre à des problèmes considérés jusqu’alors comme des fatalités (famines, pandémies…). Sans autre loi que sa propre exigence interne de vérité, refusant toute référence au bien et au mal, la science contemporaine se veut indifférente aux valeurs autres que le respect des faits, la preuve par l’expérience et le refus des dogmes.
Mais cet immense développement n’est pas neutre ; la science doit s’expliquer, aujourd’hui, avec l’humain. En effet, par les conditions sociales de son développement actuel, elle contribue à creuser les inégalités entre pays du Nord et du Sud, entre riches et pauvres au sein de nos sociétés et se plie sans réticences au règne de l’argent. Aussi, les vertus individuelles qui sont l’armature de la science n’épuisent pas le jugement moral dont celle-ci relève désormais.
La science tend à évacuer l’homme, dans ses dimensions « personnelles » et subjectives, comme en témoignent ses développements dans les neuro-sciences et dans les sciences cognitives (celles-ci promettent le décryptage de l’être, l’explication du fonctionnement humain, avec une forme de rationalisme positiviste digne de la fin du 19ème siècle).
Alors que le propre de l’humain partagé, c’est le langage, la science apparaît aujourd’hui comme une régression, parce qu’inhumaine, non-partageable, appropriée par un petit groupe de spécialistes. Les révolutions de la pensée, qui se révèle capable de lire le cosmos, le gène et le cerveau, provoquent ainsi dans nos sociétés un profond malaise, tissé d’angoisse et de peur. Au moment où la revendication d’une place pour l’irrationnel surgit de toutes parts dans la société, il est urgent de clarifier les vrais enjeux : reconnaissons à la science et à la raison, une compétence universelle, mais refusons leur prétention exclusive à parler de l’homme et pour lui. Dans les questions techno-scientifiques qui agitent actuellement l’opinion (OGM, changements climatiques, pollution atmosphérique, bœuf aux hormones…), les comités d’experts ont à s’inscrire dans des débats de société, et les politiques doivent assumer seuls la responsabilité de l’application du principe de précaution.
Face aux espaces insoupçonnés de liberté ouverts par l’aventure de la connaissance, deux remèdes, dont aucun, à lui seul, ne saurait suffire, sont à développer : la loi et l’éducation.
• La loi, non pas pour imposer un moratoire universel de la connaissance, solution utopique et irréaliste, mais pour borner tout ce qui pourrait détruire le vivre ensemble, donc la possibilité pour l’autre d’exister à côté de nous.
• L’éducation constitue la grande espérance, car une conscience humaine bien formée est droite et véridique. Dans l’éducation des enfants et adolescents, c’est une véritable révolution pédagogique qu’il convient de réaliser, afin de répondre aux peurs ou aux risques de dérive, et de restaurer une démarche positive de citoyen et d’homme debout.
Se réconcilier avec la science, en accepter les enjeux, passe par une éducation à la réalité et à la beauté intelligible du monde (celui-ci n’est pas constitué que par des boîtes noires fonctionnelles). Cela passe aussi par une éducation à la raison (qui comprend le sens de la mesure), à l’histoire (car l’aventure de la science représente le difficile effort de l’homme pour sortir du rêve de l’enfance et assumer en adulte sa condition). Cette éducation concerne également les enjeux mêmes de la science, c’est-à-dire la complexité. Cela signifie : dialogue avec les experts, écoute, esprit critique, renoncement à l’émotion facile, compréhension des ordres de grandeur, paramètres multiples, refus des causalités simplistes…
Mais l’éducation concerne aussi le sens : la science « fait de la vérité » sur le monde qui nous entoure. Cette vérité se construit dans un échange où la règle du jeu n’est pas la loi du plus fort, mais celle du plus pertinent à déchiffrer le grand livre du monde.
Enfin, l’éducation doit viser prioritairement l’éthique : la science est un enjeu de partage, de justice et de respect de l’autre.
Le débat sur les biosciences appliquées à l’homme est emblématique des questions et des enjeux éthiques où nous convoquent actuellement les avancées de la science. Devons-nous admettre le clonage reproductif des cellules et de l’embryon, leur utilisation, sans limites, à des fins thérapeutiques et pharmaceutiques ? Tout ce qui est réalisable est-il nécessairement bon ? N’adoptons pas une attitude défensive à priori, même si, dans certains cas, un moratoire peut constituer un frein à des ambitions strictement commerciales faisant fi de l’humain. Ne parlons pas de « culture de mort » à propos de techniques qui sont désirées, patiemment cherchées et mises au point, en vue de répondre à un projet parental ou de soigner des êtres humains. Opérons, plutôt, un discernement critique.
C’est à celui-ci que s’emploient les Comités d’éthique. Il s’agit d’intégrer l’évaluation utilitariste des recherches au sein d’une approche plus globale. L’enjeu est de nous rendre attentifs à ce qui, à travers l’invasion du tout génétique, peut détruire l’homme, comme personne et en société, en altérant le sens que cet homme peut donner à son existence corporelle, à ses relations de filiation et de génération, à ses relations sociales, et aux soins médicaux qu’il sollicite. Cette réflexion multidisciplinaire vise à n’oublier aucune des dimensions de l’humain.
Toutefois, ce premier pas n’est pas suffisant. Ainsi, quand les biosciences demandent, en échange de progrès thérapeutiques à venir, que soient mis à leur disposition des embryons humains devenus ainsi banques de cellules, et non plus projets d’hommes, la question est de convenir où commence et ou s’arrête la dignité de l’être humain. L’aventure scientifique et technique nous convoque ici à l’éthique de responsabilité. Ce qui constitue celle-ci, c’est le regard que nous portons sur les autres, et parmi eux, sur le plus handicapé, le plus faible. Il y aura toujours un plus faible parmi nous. Le chemin de la transcendance ne passe pas par les harangues ou les imprécations, mais par le sentiment d’humilité et de fierté d’appartenir à la même espèce et communauté humaine, aimée par Dieu et toujours reconnaissante de cet amour.
Accepter les différences entre les personnes et les cultures
Le principe de l’égalité, sur lequel se sont bâties les sociétés modernes comporte un revers : il fait de la société une abstraction. Les personnes peinent à se situer elles-mêmes et vis-à-vis des autres. La crise du lien social, c’est celle de l’identité des personnes et de leur solidarité entre elles.
Cette crise, qui n’est pas nouvelle, revêt aujourd’hui des carac-tères spécifiques. Dans l’économie, le système productif contribue à différencier les individus. La mobilité se généralise, dans le lien conjugal, dans le rapport au travail. Les hommes et les femmes ont vu leurs identités violemment secouées au cours des trente dernières années. Les uns comme les autres sont à la recherche d’un nouvel équilibre, basé sur une conjugaison entre l’égalité, qui est à consolider, et la différence qui est à réinventer.
Les institutions de la citoyenneté, qui avaient pour mission de produire la cohésion sociale, disparaissent (la conscription obligatoire), ou s’usent (le suffrage universel). Les institutions de la solidarité sont également en panne : l’Etat providence, « main invisible » de la solidarité, est aujourd’hui en déclin. Dans nos sociétés, la tentation est de segmenter afin que la solidarité se fonde sur la base de la similarité et du groupe homogène.
On passe insensiblement du principe de solidarité civique (je suis solidaire de ceux qui sont différents de moi), à un principe plus étroit, celui de solidarité de groupe (restreinte à ceux qui me ressemblent). La tentation est grande de refonder le lien social par petits groupes. Cette tendance est à l’œuvre dans le monde entier, au sein des pays et entre pays. Les uns éclatent (ex-Yougoslavie, Tchécoslovaquie…) ; d’autres menacent de le faire (Belgique, Italie, Russie…), parce qu’il y a des différences qui ne sont plus acceptées.
Deux conceptions de la solidarité s’affrontent dans le monde : la solidarité d’humanité (qui mobilise de 0,2 à 1% du PIB), et la solidarité de citoyenneté, plus exigeante, qui mobilise 45% du PIB. La tendance, dans le monde actuel, est de glisser de la seconde à la première, qui pourrait être plus généralisée, mais aussi plus faible dans son contenu et ses exigences (les pays riches, dont l’objectif proclamé était d’atteindre une aide aux PVD de 0,7% de leur PIB, l’ont en fait réduite de 0,35% en 1990 à 0,23% aujourd’hui).
La crise que nous vivons est consubstantielle de la modernité et de la société de la mondialisation. Aussi, notre premier devoir est-il de récuser les reconstitutions illusoires et négatives du lien social. Combattons le mythe du retour au passé. Écartons également la tentation du populisme nationaliste : les nations ne peuvent construire leur unité autour d’un principe fictif d’unanimisme (cf. la coupe du monde de football), qui dispenserait de penser et de gérer la pluralité. Les nations modernes ne sont plus un groupe d’individus qui se ressemblent, mais un espace de différences acceptées, de redistribution partagée. La solidarité de citoyenneté est constitutive du pacte social ; elle en est le contenu même. C’est à partir d’elle que l’on pourra bâtir une solidarité d’humanité plus ambitieuse qu’actuellement. Sans ignorer que l’homme ne se relie à l’humanité ue par son appartenance à des groupes intermédiaires. A commencer par la famille. N’affaiblissons pas, mais renforçons ce tout premier lien social. N’oublions pas qu’un exclu est d’abord un exclu de sa famille.
Même avec la croissance économique revenue, le chômage structurel de longue durée, la violence urbaine, la ghettoïsation des banlieues, l’exclusion des personnes d’origine étrangère (perceptible dans le logement, l’école, les entreprises), restent entiers. Ils sont la pierre de touche de notre volonté et de notre aptitude à prendre en compte la situation de tous nos concitoyens, et en particulier des plus défavorisés.
La première pauvreté, c’est l’absence de travail, le sentiment d’inutilité sociale et de non-considération de soi qu’elle génère. La loi contre l’exclusion, l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2.000, de la Couverture maladie universelle, les dispositions visant à consolider les droits des femmes, sont des avancées significatives ; mais il faut aller plus loin. Le contrat social de la société post-industrielle reste à inventer. Il devra assurer l’équilibre entre sécurité et flexibilité, garantir un droit à l’initiative et à la formation tout au long de la vie (universaliser les droits de chacun à la réussite), offrir à tout citoyen de larges possibilités de travail à temps choisi et de participation à la vie associative. Plusieurs pistes s’ouvrent, pour ce faire, à la réflexion.
Dans notre pays, parvenons à la conclusion d’un pacte national de solidarité, avec pour objectif de faciliter la conclusion de pactes locaux. Ces pactes (qui concerneraient, entre autres, le logement social, les politiques publiques d’emploi, de formation professionnelle…) lieraient tous les acteurs : l’Etat, les collectivités locales, les Caisses de sécurité sociale, les entreprises, les associations…, ainsi que les bénéficiaires eux-mêmes, questionnés sur leurs besoins et, par suite, responsabilisés. C’est dans un tel cadre que pourrait être menée une nouvelle approche décloisonnée des problèmes de l’Ecole, permettant d’associer tous les acteurs locaux (parents, élèves, enseignants, élus, entreprises, transporteurs, militants associatifs…) à la recherche de solutions adaptées. Des expériences réussies montrent la voie.
C’est dans ce même souci d’adaptation aux réalités, que s’impose, aujourd’hui, la mise en place de filières de formation aux nouveaux métiers de la vie sociale : afin de former ces acteurs et actrices d’un type nouveau, chargés de créer les conditions de la convivialité, du dialogue, de l’écoute et de la médiation, dont notre société actuelle a le plus grand besoin.
Le fondement anthropologique de toute société humaine est celui de l’échange de dons et la réciprocité. Faire confiance, restaurer la dignité et la considération de soi des personnes, implique que l’on sorte de l’assistanat généralisé : on ne peut définir les droits et devoirs de la société vis-à-vis des exclus, sans traiter également, avec un souci de proportionnalité, les droits et devoirs des exclus à l’égard de la société.
Sur de telles bases, une synthèse entre l’autonomie des personnes et l’aventure collective est possible, à l’échelle des nations comme entre les nations. Elle a pour finalité de permettre à chacun de se construire comme personne, en liaison avec les autres. Telle est la trame du lien social d’un type nouveau, sur laquelle nous devons bâtir la société de la mondialisation qui ouvre ce troisième millénaire.
Un tel objectif est un défi pour tous. Il l’est, en particulier pour les chrétiens et pour l’ensemble des Eglises chrétiennes, qu’il met en demeure d’être fidèles, ensemble, à l’appel de leur fondateur né il y a deux mille ans. Mais, par les espaces nécessaires d’écoute, d’accueil de l’autre, qu’il implique, cet objectif ouvre aussi la voie au dialogue interreligieux. Celui-ci est nécessaire pour aider à repenser les rapports entre minorités et majorités ethniques, pour donner à l’idée de nation son visage moderne, pluriel, celui de la société humaine mondialisée, appelée à parfaire son unité dans la reconnaissance du Tout Autre.
François Desouches