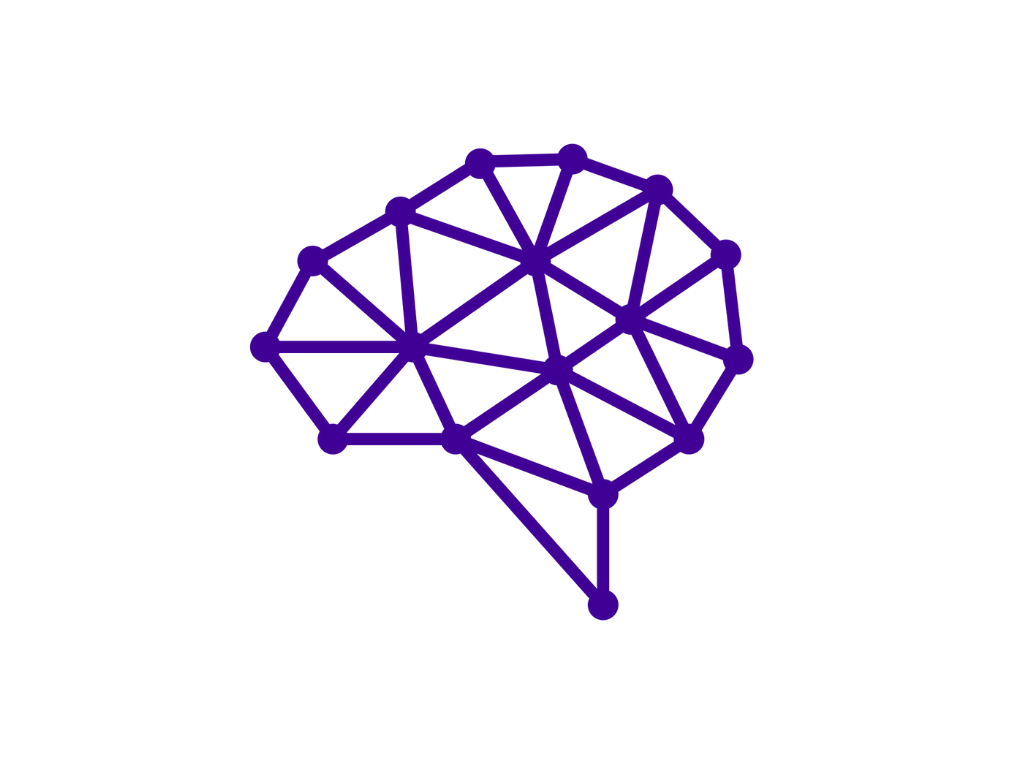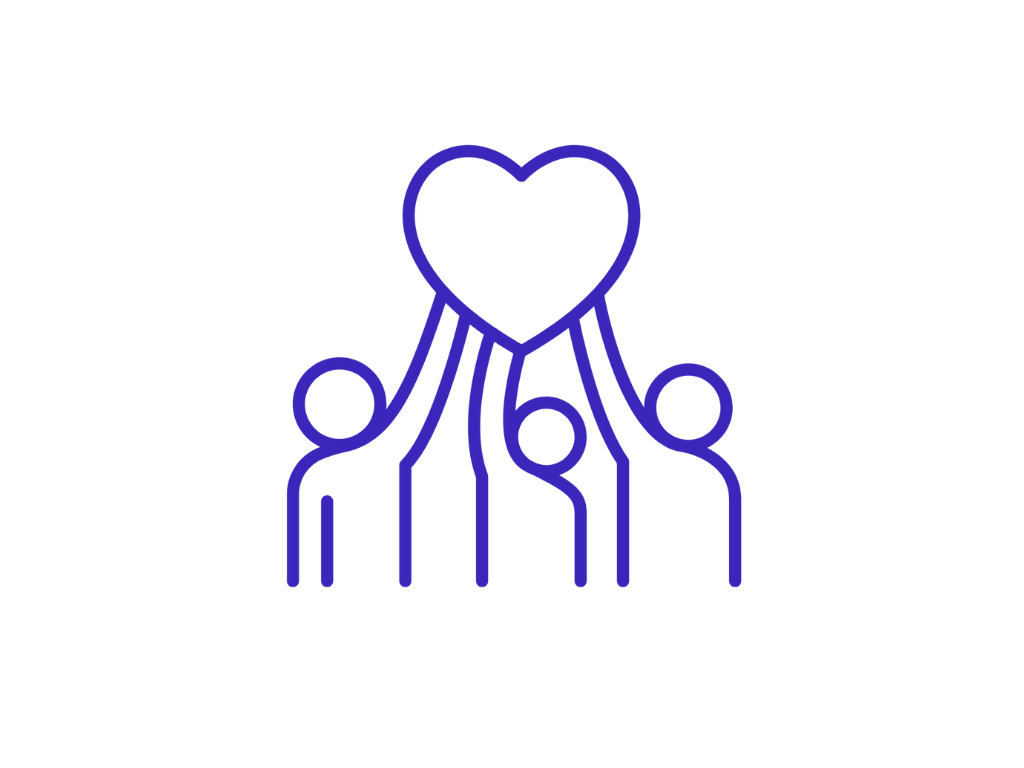Table ronde donnée lors de la session 1998 des Semaines sociales de France, « Démocratiser la république, représentation et participation du citoyen »
Table ronde présidée par José de BROUCKER, avec la participation de Jacques JULLIARD et de Bernard STASI
Ce matin, Jean Boissonnat a évoqué Georges Burdeau qui considérait la démocratie comme étant avant tout un mouvement. Le moteur de ce mouvement, c’est la volonté du peuple. Ainsi, selon qu’elle sera active ou passive, la démocratie ira de l’avant ou patinera, s’enlisera, et peut-être même se dévoiera.
Alors, que demande le peuple? On n’en sait rien de science certaine. Tout ce que l’on peut en dire résulte d’interprétations d’indicateurs divers : participations électorales, sondages d’opinion, initiatives et engagements associatifs, stratégies de groupes de pression, manifestations de rues, etc.
Ces indicateurs donnent à penser qu’il peut y avoir un hiatus entre les vœux et les comportements. Les vœux sont adressés au système politique que les citoyens veulent plus participatif et à ses agents qu’ils souhaitent plus jeunes, plus humains, plus féminins, plus proches, et surtout plus vertueux. Les comportements traduisent tantôt des sentiments individuels d’impuissance ou de découragement, tantôt des attitudes d’autodéfense catégorielles, tantôt aussi — et j’espère qu’on ne l’oubliera pas — des engagements imaginatifs, courageux, exemplaires. Ainsi se mêlent les aspirations du peuple souverain, soucieux du bien commun, et celles du peuple sujet, soucieux de ses intérêts particuliers. Ces aspirations sont à la fois porteuses de chances, porteuses de risques pour la démocratie. Quelles chances ? Quels risques ? Société civile — cela a été évoqué ce matin — et société politique peuvent-elles faire cause commune?
Je remercie dès maintenant Jacques Julliard et Bernard Stasi d’avoir accepté d’informer notre réflexion, chacun de son point de vue, qui sera peut-être pour l’un plutôt le point de vue du citoyen; pour l’autre, le point de vue des pouvoirs.
Jacques Julliard
Je prends la parole le premier parce que je suis censé « faire le citoyen», cependant que mon ami, Bernard Stasi, est censé « faire le pouvoir». J’ai le sentiment que je vais vous décevoir, mais comment faire autrement… Je n’arrive pas en effet à me couler dans cet habit du citoyen tel que nous l’avons connu et rêvé dans les années soixante, c’est-à-dire une personne aspirant à de plus en plus de participation démocratique, introduisant le souffle de la société civile à l’intérieur des sphères viciées de la société politique, bref, un citoyen paré de toutes les vertus, de toutes les aspirations de la démocratie face à un système résistant.
En les lisant, je n’ai pu m’empêcher de remettre en cause les termes annonçant les exposés de cette session. Il m’a semblé que leur formulation tenait beaucoup à la fois à notre passé et à nos idéaux, et moins à la réalité. En ce qui concerne notre intitulé, «Les nouvelles aspirations du citoyen et les structures de pouvoir», je me demande si ces aspirations sont aussi nouvelles que cela. Et, si elles sont nouvelles, est-ce bien du citoyen qu’elles émanent? C’est surtout de cette question que je voudrais vous entretenir. On a pris l’habitude de voir la base, parée de toutes les vertus, interpeller le sommet. Il est en effet nécessaire d’interpeller les élites. Il n’y a pas de démocratie sans les exigences renouvelées du citoyen. Cet idéal de la vie politique n’est pas aussi nouveau qu’on l’imagine. Il est aussi ancien que la République. Alain, le philosophe de ce radicalisme qui domina longtemps la France, traduisait cela en disant : «Obéir en rouspétant, obéir en résistant, c’est tout le secret. »
Ce jeu de fonction entre les citoyens et le pouvoir est-il encore suffisant? Et surtout, les choses se passent-elles ainsi aujourd’hui? J’en doute. Cette formulation suppose un peuple qui pose les bonnes questions, et surtout des citoyens vertueux qui se placent du point de vue de l’intérêt général. Or le citoyen est en train, d’une manière « dramatique » — au sens anglo-saxon du tenue —, de s’effacer derrière l’individu. On est passé de la vision idéale de l’exercice de la souveraineté du peuple à la garantie des droits de l’individu. De moins en moins de groupes — syndicaux, politiques, confessionnels, idéologiques — tiennent compte dans leurs revendications du point de vue de la citoyenneté, c’est-à-dire de l’intérêt général. Un exemple significatif est celui des syndicats qui, s’ils représentent par définition un groupe aux intérêts particuliers, avaient développé dans les années soixante et soixante-dix de véritables projets de société. Depuis, on a vu les groupes syndicaux revenir— on a parlé de «recentrage» pour la CFDT, on en parle aujourd’hui pour la CGT – à des objectifs beaucoup plus limités.
Corrélativement, on est passé de la revendication du règne de la majorité à celle de la défense des minorités. Ainsi, l’idée qu’on ne parle jamais pour tout le monde est en train d’entrer dans la mentalité commune. Dans le meilleur des cas, on parle pour un groupe particulier qui s’est défini, contrairement aux règles élémentaires du rousseauisme démocratique, par la défense d’un intérêt particulier. Et tous les intérêts sont devenus légitimes aux yeux de la société. Ainsi, nous en arrivons à la fois à une négation du syndicalisme et en même temps à un phénomène de «pan-syndicalisation». Dès lors que vous parlez au nom d’un groupe, vous avez — même pour dire des absurdités — un niveau de légitimité qui n’a jamais été acquis précédemment. Le droit de parler en marge de l’intérêt général était traditionnellement reconnu, dans nos sociétés libérales et démocratiques, aux groupes représentant les plus défavorisés ou les plus faibles. Aujourd’hui, il suffit de se mettre en colère — que l’on soit au SMIC ou que l’on gagne énormément d’argent —pour que l’intérêt particulier porté par un groupe soit reconnu comme tel par le politique qui voit là des électeurs.
Enfin, on est passé de la souveraineté du citoyen électeur à la victimisation de l’individu. Pascal Broucker a montré qu’aujourd’hui la légitimité repose avant tout sur la condition de victime. Ce phénomène qui nous vient des États-Unis prend des proportions extraordinaires.
Ainsi, il me semble que le rôle pervers qu’on fait jouer à l’histoire dans nos sociétés vient du fait que chacun recherche des raisons de se considérer comme victime du passé, et de tirer des traites sur les souffrances qu’ont connues nos parents ou nos ancêtres. Aux États-Unis, les Noirs revendiquent moins en fonction de leur situation présente qu’en fonction de la situation abominable qu’ont connue leurs ancêtres. Cette démarche qui se généralise aboutit à cet immense gémissement montant d’une société qui — sans négliger la misère qui y existe aussi — n’a jamais été aussi prospère. L’intensification du gémissement n’est pas en rapport avec le degré de souffrance. Il est même souvent inversement proportionnel. Ainsi, les sociétés démocratiques fonctionnent désormais non pas à la volonté générale, niais à la commisération et à la pitié.
Télécharger le pdf