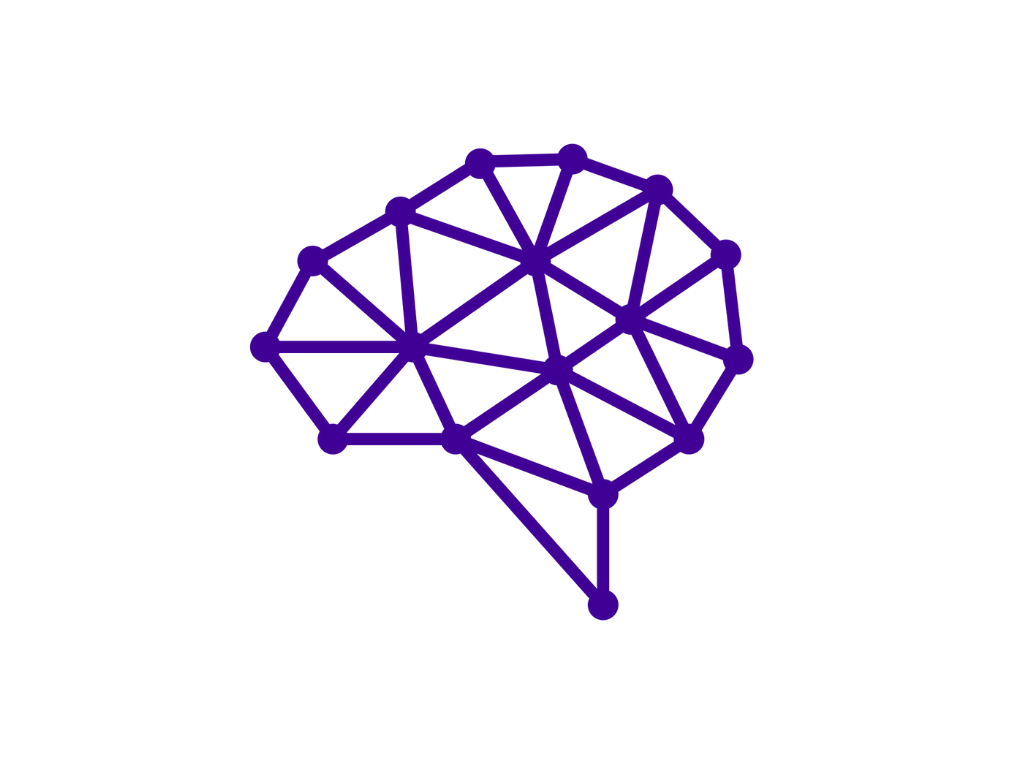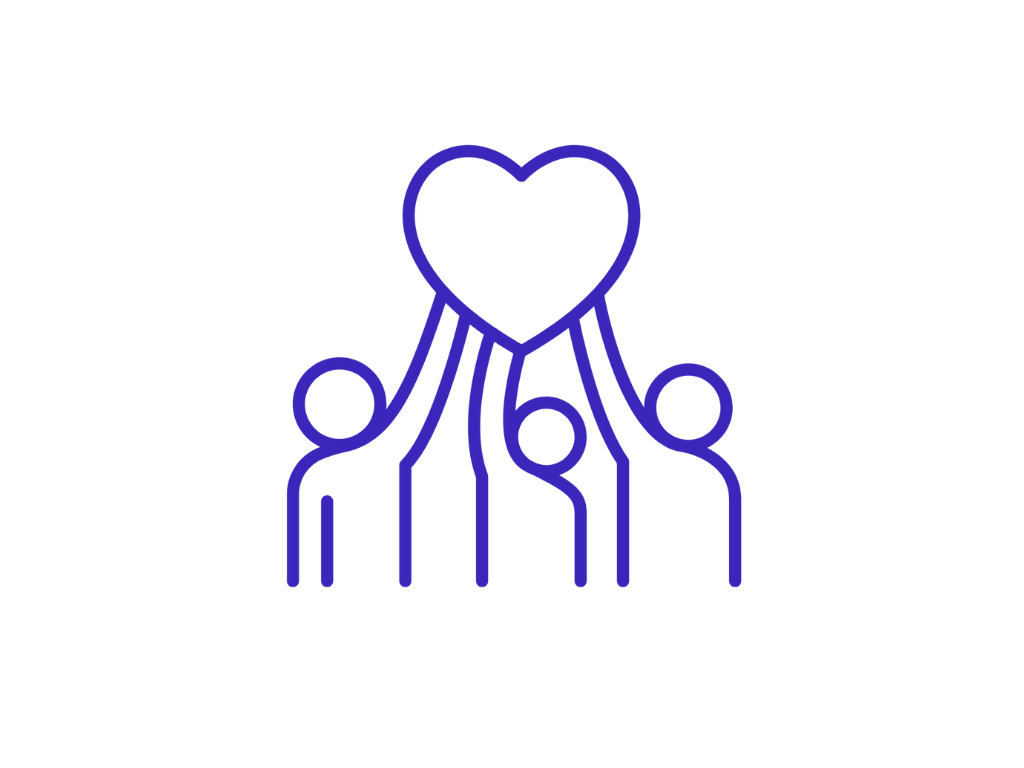Conférence donnée lors de la session 1999 des Semaines sociales de France, « D’un siècle à l’autre, l’Evangile, les chrétiens et les enjeux de société »
Pierre ROSANVALLON, sociologue, écrivain
Que l’on s’intéresse au syndicalisme, que l’on s’intéresse à la famille, que l’on s’intéresse au travail, que l’on s’intéresse à la ville… partout flotte un air de décomposition du social. Mais comment déterminer les causes profondes de cette décomposition ? La « crise du lien social » suscite immédiatement deux catégories différentes de questions : celles qui ont rapport à la crise des identités, et celles qui ont rapport à la crise des solidarités.
Quand on parle de crise du lien social, c’est tout d’abord admettre que chacun a un rapport moins évident à lui-même, un rapport moins évident aux autres pour se déterminer, en somme qu’il y a un problème à la fois d’identité personnelle mais aussi de lisibilité de la société.
Mais la crise du lien social, c’est aussi et peut-être d’abord une crise des solidarités. Que l’on parle d’État-providence, que l’on parle de solidarité entre nations développées et nations en développement, et l’on pense aussitôt à toutes ces institutions internationales organisatrices ou ces instances chargées de réguler la solidarité entre groupes sociaux, entre nations. Ces mécanismes semblent aujourd’hui en panne. C’est en ce sens-là que l’on peut parler de crise du lien social ; les hommes et les femmes sont moins évidemment reliés entre eux et ils sont moins évidemment reliés à eux-mêmes.
Mais faire ce constat, c’est tout de suite apporter deux précisions, me semble-t-il, très importantes. La première, c’est qu’il ne faut pas croire que la crise du lien social soit simplement un problème contemporain. En effet, ce qui est frappant pour l’historien, c’est de voir que la situation que nous connaissons aujourd’hui est très comparable à celle du début du XIXe siècle, c’est-à-dire de l’époque moderne. Royer-Collard, un auteur qui eut alors son heure de gloire et fut le père spirituel de Tocqueville, a écrit en 1820 un texte célèbre dans lequel il dit : « Maintenant, la société est en décomposition ; elle est en poussière. La révolution n’a laissé debout que des individus. » C’est dire que ce constat d’une société qui se délitait était d’actualité dès cette époque. Et ce, parce que l’image d’une société qui se désagrège, dans laquelle les solidarités apparaissent moins éprouvées, dans laquelle les identités apparaissent plus vulnérables, est celle de la modernité en général !
Pourquoi ? Pour deux raisons très simples : la modernité n’assure plus la cohésion sociale à travers l’intégration des différences d’une part et à travers la communauté des croyances d’autre part.
Qu’est-ce qui forme le lien social dans une société traditionnelle ? Ce sont les différences qui, reconnues comme assignant chacun à une place déterminée dans un ensemble différencié et hiérarchisé, permettent d’intégrer les individus ; l’« Ancien Régime », en France, en offre un parfait exemple : dans cette société de corps, de différences, d’inégalités, de ségrégations, le mot « exclu » n’a pratiquement pas de sens parce que chacun trouve sa place à l’intérieur même des cloisons sociales. On peut dire que le principe d’intégration, le principe de cohésion d’une société traditionnelle, est fondé sur la reconnaissance et l’organisation sociale des différences et des hiérarchies.
A celui-ci s’ajoute un deuxième principe de cohésion qui est celui de la communauté des croyances ; en France, la croyance en Dieu et l’adhésion à la foi catholique. Après la Révolution française, pour prendre un point de repère facile, la nouvelle société, reniant celle, traditionnelle, d’Ancien Régime, en prend l’exact contre-pied, en imposant le principe de l’égalité des citoyens entre eux et celui de la sécularisation qui sont, pour ainsi dire, les deux mamelles de la crise du lien social.
Je vous invite en effet à réfléchir sur ce paradoxe du monde moderne. En imposant, par idéologie, le principe d’intégration par l’égalité, nos sociétés tendent à rendre les citoyens de plus en plus abstraits. L’individu se définit par son sexe, par son âge, par le groupe social auquel il appartient, par son métier, par sa fonction, par son niveau d’éducation, de formation… Or, la puissance de la citoyenneté parvient à occulter toutes ces différences pour les ramener à un principe abstrait. Nous sommes citoyens au-delà de toutes nos singularités, nos spécificités ! Dès la Révolution pourrait-on dire, il a même été fait une interprétation discutable du fameux adage de saint Paul qui dit : « Il n’y a plus de Juifs, il n’y a plus d’Hébreux, il n’y a plus de Romains. Il n’y a plus que des chrétiens. » Le paraphrasant, Saint-Just disait : « Il n’y a plus de Bretons, il n’y a plus de Normands. Il n’y a que des Français. » Mais en parodiant saint Paul il ne faisait pas que proclamer, « sacraliser » un principe d’égalité, il reconnaissait en même temps que ce qui fonde le lien social dans la société contemporaine, c’est l’abstraction et son corollaire : le manque de lisibilité et de cohésion.
Nous réalisons, à travers ce cas, que le problème qui nous occupe ici ne remonte pas aux années soixante-dix ou aux années quatre-vingt, mais aux origines de notre monde dit « moderne ». Celui-ci, en ayant rompu avec les anciennes structures communautaires, sociales ou religieuses, va se chercher des ersatz de « communion spirituelle ». D’où le besoin, alors même que la Révolution n’est pas achevée, de réinventer des formes de religion, que ce soit à travers le culte de l’Être suprême, institué par l’un des plus ardents contempteurs du clergé, ou à travers la longue quête dans laquelle les historiens du XIXe siècle, comme Michelet, comme Quinet, se lancent, pour essayer de ressusciter l’existence d’un principe spirituel entre les Français, pour leur donner un socle commun. Michelet dira que c’est en faisant exister la société française et la France comme une unité spirituelle qu’il cherchera à lui redonner cette unité de croyance qu’elle avait perdue à travers le fait religieux.
Toutefois, la crise du lien social ne peut pas simplement être considérée comme une chute, une rupture, un déclin, l’éloignement d’avec un monde qui aurait été en lui-même bon, mais elle doit être comprise comme une recomposition. Le problème est que nous n’avons pas encore saisi les principes organisateurs et les faits générateurs de cette recomposition. Tentons de poser quelques points de repère.
Le premier élément important à mes yeux est d’ordre quasiment anthropologique et culturel : c’est le fait que le rapport à autrui, fondé jusqu’il y a peu sur l’idée de communauté — communauté d’entreprise, communauté familiale… —, sur l’idée de contrat, a changé de nature. Cela pour des raisons qui s’expliquent à la fois par les changements de l’économie et les changements de la société.
Les changements de l’économie tout d’abord. Il nous est encore difficile de mesurer à quel point la troisième révolution industrielle que nous vivons aujourd’hui est en passe de bouleverser de façon radicale notre société, non seulement à cause de l’accélération des découvertes techniques, mais parce que la nouvelle donne économique engendre une société différente.
La société de la deuxième industrialisation, que nous avons quittée il y a seulement une quinzaine d’années, était fondée sur la standardisation de la production et sur la consommation de masse. Conséquence sociale majeure : elle contribuait à homogénéiser la société.
Prenons l’exemple de la production à la chaîne, archétype du mode de production de cette période. Dans les ateliers, on pouvait mettre côte à côte des paysans, des ouvriers, des villageois tunisiens, marocains, turcs ou yougoslaves… on pouvait mélanger les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux… le processus de production ramenait tout le monde à une même unité, à une même communauté relativement homogène, une communauté de travail, une « force » de travail, comme les économistes et les idéologues disaient alors. Engels formula une réflexion fameuse : « A quoi sert une usine ? Une filature ? Elle sert à produire du coton et des pauvres. » On peut dire : « À quoi sert une usine moderne dans le XXe siècle ? Elle sert à produire de la production de masse standardisée, et en même temps à produire une classe ouvrière et un salariat, de façon plus large, relativement homogène, au-delà d’un certain nombre de différences. »
Alors qu’aujourd’hui, comment s’organise le système productif naissant ? En faisant, contrairement au précédent, appel à la particularité, à l’intelligence, à la compétence, au savoir précis, à la capacité de chacun à réagir. Cela n’est pas simplement vrai pour ceux qui travaillent dans des laboratoires de recherche, dans le domaine des technologies de pointe… Même dans des travaux apparemment très répétitifs, comme celui d’une caissière de supermarché, d’un contrôleur dans une entreprise… il faut en permanence prendre des initiatives, réagir à une petite panne, prévoir les défaillances d’un système, s’adapter aux réalités qui à chaque fois mettent à l’épreuve vos capacités personnelles.
À la « masse salariale », à la « force de travail » de la deuxième révolution industrielle, succède la compétitivité du travailleur moderne, évaluée par des sociétés d’audit, La conséquence sociale fondamentale de ce changement de conception est la réapparition de types d’inégalité, de types de sociabilité complètement différents. Les entreprises, en effet, vont de plus en plus se constituer non plus comme d’immenses systèmes productifs extrêmement homogènes, mais comme des petites unités de production à l’intérieur desquelles se recréera une homogénéité.
Il y a une dizaine d’années à peu près, la navette Challenger explosait en vol. Était-ce parce que les techniques de pointe informatiques qui avaient été employées n’étaient pas à la hauteur ? Non. Mais parce qu’un petit joint qui coûtait l’équivalent de 20 centimes s’était rompu ! Les experts et les économistes en tirèrent la conclusion que, dans le système moderne, la qualité ne se pense pas en termes de moyenne mais d’homogénéité. Donc, le sort d’une navette spatiale ne dépend pas uniquement du degré de sophistication technologique dont elle bénéficie, mais de l’attention accordée à toute la chaîne de production, qui doit être aussi soutenue pour la fabrication des boulons que pour celle du système de pilotage automatique.
Ainsi voit-on les entreprises se restructurer de façon complètement différente. Les immenses systèmes productifs tendent à disparaître au profit d’agences spécialisées. La conséquence, c’est ce qu’on a appelé la multiplication des « systèmes d’appariements sélectifs ». C’est-à-dire que la société moderne apparie, elle met ensemble des travailleurs ; mais, par une sorte de sélection extrême, les plus performants se trouvent avec les plus performants, les moyennement performants avec les moyennement performants et les moins performants avec leurs semblables. Des exclusions, des inégalités de type nouveau se reconstituent ainsi, dues aux mutations économiques, mutations que nous avons du mal à analyser parce que nous les vivons et que nous ne sommes qu’au début du processus.
À la raison économique qui a opéré un changement de nature de la société s’ajoute une raison d’ordre anthropologique et culturel, comme je l’évoquais plus haut. Prenons un exemple : celui des élections. En recourant à cette notion d’identité-appartenance, les sociologues ont pu expliquer un des facteurs les plus mystérieux de la société sur le long terme : la stabilité électorale sur un siècle et demi. On constate en effet que la carte électorale de France de 1849 reste pratiquement invariable jusqu’aux élections de 1978, à quelques nuances près, et que le clivage droite-gauche qu’on lit à ce moment-là se retrouve à peu près inchangé tout au long de la période. Ce phénomène est incompréhensible si on estime que le vote dépend simplement de facteurs culturels, professionnels…parce qu’en cent cinquante ans la société n’a cessé de se recomposer.
Alors pourquoi cette permanence ? Un des maîtres de René Rémond a donné une explication lumineuse de ce phénomène en avançant que le vote n’avait pas simplement une fonction de choix personnel, mais qu’il avait aussi une fonction d’identification collective. Voter, ça n’était pas simplement exprimer une préférence individuelle, mais affirmer une appartenance.
Cela a complètement changé, justement à partir des années quatre-vingt. Ont émergé alors ce que les spécialistes de sociologie électorale appellent les « électeurs stratèges » et s’est constitué ce qu’on a appelé aussi « l’électorat volatile ». En clair : à partir de ce moment-là les stratégies personnelles prévalent sur les logiques d’appartenance dans les comportements politiques. Ce qui se manifeste dans ces derniers est révélateur du changement radical qui s’opère à l’échelle de la société concernant les comportements sociaux.
Télécharger le pdf