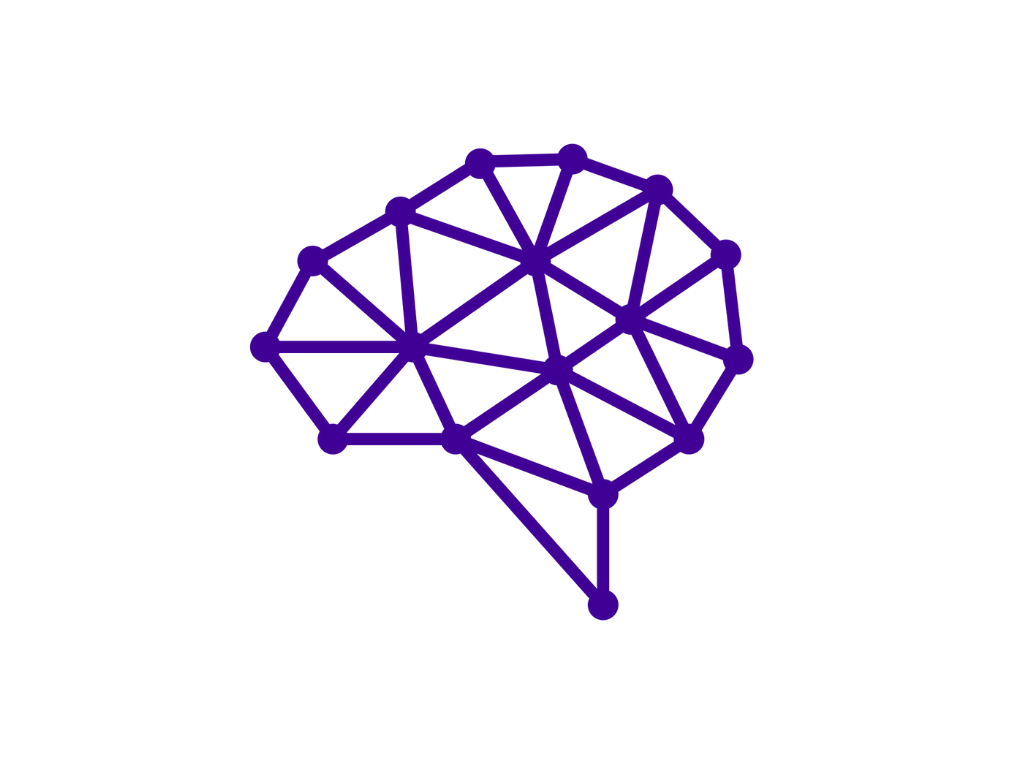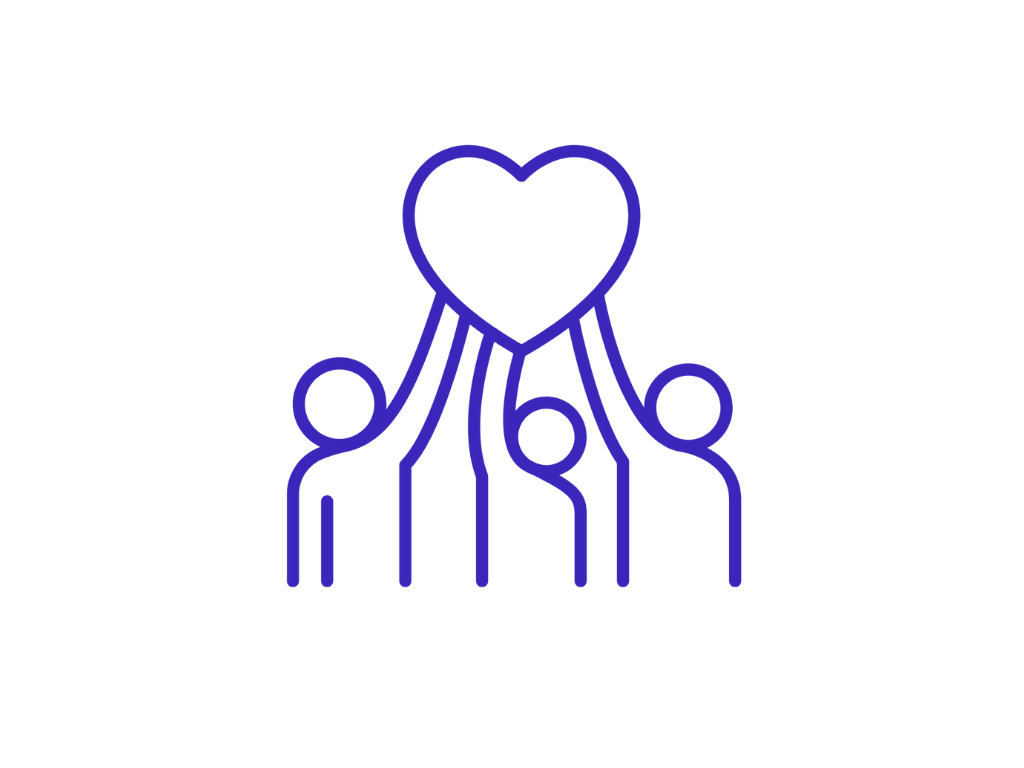Pierre Rosanvallon est historien, directeur d’études à l’EHESS.
Je voudrais en ouverture partir de deux remarques sur les images et sons d’archives de l’appel de l’Abbé Pierre en 1954 que nous venons de voir. S’il y a eu l’Abbé Pierre de 1954, je rappelle qu’il y a eu trente ans après un deuxième Abbé Pierre. Le premier, à l’aube des Trente Glorieuses, dénonce une misère de condition, celle de l’héritage de l’entre-deux-guerres, des difficultés de la fin de la guerre. Le second, dans les années 80, parle de « nouvelles pauvretés ». On a réalisé en effet à ce moment-là qu’il y avait non pas une réapparition de l’ancienne pauvreté de condition, mais l’apparition d’un nouveau type que j’appellerai une pauvreté de situation, dont les formes de production sociale ne
sont pas de même nature. Il est impressionnant que ce soit la même personne qui ait symbolisé à ces deux moments la prise de conscience et le réveil de la société – puisque le terme d’insurrection a même été employé alors : insurrection du cœur, insurrection de l’intelligence, de la prise de conscience. Deuxième remarque à propos de ces images : il est frappant de constater que l’Abbé Pierre n’appelle pas simplement à une aide économique, mais aussi à une proximité sociale. Il ne dit pas « on va t’aider », mais « reprends espoir ; rentre avec nous ». Ces éléments me semblent fondamentaux.
S’il peut paraître nécessaire aujourd’hui de refaire un détour par l’histoire pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes, c’est parce que je n’hésite pas à parler d’une contre-révolution silencieuse de la désolidarisation sociale. Pour bien prendre la mesure de cette contre-révolution, permettez-moi de refaire un certain nombre de points d’histoire.
La solidarité comme ‘dette publique et sociale’
Dans notre histoire, comme dans l’histoire d’autres pays européens, la fin du XVIIIe siècle – la Révolution française marque évidemment une date à cet égard – fait passer à un nouveau régime de la solidarité. Il ne s’agit plus simplement d’un exercice de la compassion personnelle, mais la tentative de définir la solidarité comme une institution sociale, en la considérant comme ‘une dette publique et sociale’, expression célèbre martelée sur tous les tons pendant la Révolution. Que la solidarité soit une dette publique et une dette sociale pose aussitôt la question de savoir comment l’exercer, comment l’instituer, quelle forme lui donner. On rejoint là une idée fondamentale : c’est que la solidarité ne saurait jamais être seulement réparatrice ; elle est aussi une qualité du lien social, elle est une forme de la même appartenance à la collectivité. C’est pour cela que, dès le début, la Révolution place sur un même pied ce qui apparaît alors comme l’objectif essentiel : assurer l’indépendance et l’autonomie de chacun dans la communauté d’une part, être membre de la communauté d’autre part. Il s’agit de compter soi-même pour quelque chose, et c’est seulement en cas de difficulté, notamment une absence de travail, une invalidité, quelque chose qui vous empêche d’être autonome, qu’il faut trouver les moyens de vous aider matériellement. Mais les ‘secours publics’, comme on dit à l’époque, ne sont considérés que comme un palliatif par rapport à un devoir d’intégration sociale.
Le grand problème sera la difficulté de donner figure à ce devoir d’intégration sociale. Dès les débuts de la Révolution, des personnes sans travail et sans emploi demandent cette intégration. En réponse, on met en place pour les femmes des ‘ateliers de filature’, pour les hommes des ‘ateliers de charité’. Les organiser sur une large échelle n’a guère été facile. Ce sera la même chose une cinquantaine d’années après, en 1848, avec les ateliers nationaux : ces offres d’emplois publics dirigées par les municipalités apparaîtront comme difficiles à mettre en oeuvre. Et dès lors, il y aura en permanence dans la société française un écart entre la générosité des principes et le caractère extrêmement limité des institutions mises en oeuvre réellement. N’oublions jamais qu’au milieu du XIXe siècle les dépenses sociales ne représentent que 0,3 % du PIB. Comparons avec les chiffres des dépenses sociales aujourd’hui : pratiquement 100 fois plus en pourcentage du PIB.
Les expérimentations de la Révolution et leurs limites
Pendant la Révolution, on oscille donc entre l’exaltation et le bricolage. On le voit dès l’année 1790 : partout on dit, selon une formule célèbre de Billaud-Varenne, que la société ne doit être considérée que comme un « échange journalier de services réciproques entre les citoyens » – un échange journalier de secours réciproques également. Le même Billaud-Varenne écrit : « concentrer le bonheur en soi-même, c’est s’isoler aux dépens de l’association civile. Il faut intéresser chaque citoyen sentimentalement par l’espoir de la réciprocité à donner toutes ses facultés pour le soulagement et l’assistance de ses frères malheureux ». C’est une chose que l’on a oubliée, même les historiens : pendant la Révolution française, on multiplie les fêtes pour créer du lien social, du lien civique et un sens de la fraternité. On organise même le 11 mai 1794 une fête du malheur conçue comme une sorte de pédagogie des vertus sociales pour lier les droits de l’indigent à la manifestation d’un lien de fraternité. Le grand poète André Chénier écrit : « il faut développer le sens de la solidarité en gouvernant l’imagination des hommes ». Gouverner l’imagination des hommes pour que d’eux-mêmes ils deviennent fraternels est peut-être possible dans la chaleur communicative d’une fête du malheur, mais répété tous les jours, cela s’avère beaucoup plus difficile. D’où, à la fin de la Révolution, cet aveu d’échec qui se termine par la mise en place d’un ensemble de lois, de règles et d’institutions, et par l’abandon du grand projet d’institutions publiques de la solidarité pour faire confiance simplement à la bienveillance particulière. La bienfaisance nationale ne peut être que limitée, alors que la bienfaisance particulière doit être générale et réputée un devoir, dit-on. C’était donc l’acceptation de cette dissociation entre principe de solidarité et réalité silencieuse de son abandon.
Dès la période révolutionnaire, la question de la solidarité apparaît donc liée à une contradiction, une aporie : comment faire aller ensemble des droits et des obligations ? Peut-on assortir des droits d’un contrôle des comportements ? Peut-on valoriser une forme d’indépendance et, en même temps, donner des secours ? Quels sont les liens entre la citoyenneté et la pauvreté ?
Assistance sociale et contrôle des comportements versus reconnaissance de l’autonomie
Pendant le XVIIIe et l’essentiel du XIXe siècle, on résout ces questions du lien citoyenneté/pauvreté en associant l’assistance sociale à un contrôle sévère des comportements. Ce sera le cas en Angleterre : qu’est ce qu’une working poor house si ce n’est un endroit où l’on enferme des pauvres ? Un des grands thèmes de l’économie politique de la période est d’ailleurs de comparer la situation du pauvre ou du prolétaire moderne – les deux sont presque considérés comme équivalents – avec celle de l’esclave antique. On explique que l’esclave au moins ne mourait pas de faim, qu’il était dans la dépendance absolue mais, comme instrument de travail, qu’il était garanti d’être à peu près entretenu. Se poursuit donc cette oscillation entre, d’une part, une assistance payée par le prix d’un contrôle et, de l’autre, une indépendance reconnue, mais avec pour conséquence le refus de reconnaître véritablement un devoir de solidarité.
Dans la fin des années 1830 et les années 1840, une idée intermédiaire est expérimentée, notamment dans les milieux catholiques très importants partout en Europe : les colonies agricoles. Il s’agissait d’organiser un retour à la campagne des pauvres et des prolétaires, à la fois pour les moraliser, leur donner un emploi et les arracher à ce qui apparaissait non pas seulement comme une forme de production, mais comme un modèle de corruption . L’aporie de la solidarité reste cependant irrésolue en termes institutionnel et juridique pendant tout le XIXe siècle. On ne sait reconnaître la solidarité que comme un devoir moral, pas comme une institution publique. On parle pourtant à l’époque de ‘charité légale’. On s’interroge : ne faut-il pas, à côté de la charité privée, trouver des formes de ‘charité légale’ ? Mais, alors qu’on l’appelle de ses vœux, on échoue à la définir juridiquement et à lui donner des institutions. D’où l’oscillation permanente déjà soulignée, qu’il faut relier également aux débats liés à la conquête du suffrage universel. En effet, qu’est-ce que le suffrage universel, si ce n’est reconnaître l’égalité et l’autonomie ? Comment donc donner sur le plan politique l’autonomie et l’égalité, et de l’autre côté considérer que le pauvre ne peut avoir des droits que s’il se soumet à des formes de contrôle et de dépendance ? Comment produire une société des égaux en politique, si une société de la dépendance continue à régner dans le monde social ? Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que ces apories trouvent une forme de solution et de résolution. Il n’est pas exagéré alors de parler d’une révolution de la solidarité et de la redistribution. Trois facteurs ont convergé pour aboutir à cette révolution : une révolution intellectuelle ; une révolution politique ; une révolution institutionnelle.
Une révolution intellectuelle
S’opère tout d’abord une rupture avec la vieille vision individualiste de la société qui datait de la Révolution française, mais qui s’imposait à tous à ce moment-là. Partout sur le continent, avec ‘les nouveaux libéraux’ en Angleterre, ‘le socialisme de la chaire’ en Allemagne, les sociologues comme Fouillée et Durkheim, ou les républicains sociaux comme Bourgeois en France, s’impose l’idée que les sociétés ne sont pas des composés d’individus et qu’elles doivent être comprises comme des ensembles et des totalités. Même la biologie se met de la partie puisque Pasteur révèle après tout une chose extraordinaire : derrière l’apparent isolement des individus, un lien invisible circule, celui des virus et des microbes . Les sociologues et les scientifiques aboutissent au même constat : les sociétés sont des organismes interdépendants ; il n’y a donc pas de société sans ‘dette sociale’. La dette sociale n’est pas une sorte de supplément d’âme du monde moderne, elle doit lui être consubstantielle. Cette révolution intellectuelle entraîne ce qui est fondamental : une révolution du regard sur la solidarité. On comprend alors que l’objectif de la société moderne n’est pas simplement l’indépendance, mais aussi de « faire du commun ».
S’ajoute à cela une deuxième révolution intellectuelle : tout simplement l’introduction de la notion de risque. On découvre que les difficultés sociales – ou la pauvreté, pour employer cette terminologie – ne sont pas simplement de l’ordre de la condition, mais relèvent de situations de risque. C’est parce qu’on a été victime d’un accident du travail ou que quelqu’un dans sa famille est décédé ou bien encore que l’on se trouve malade, que l’on perd son revenu et que l’on « dévisse » de sa situation. Les problèmes sociaux peuvent donc être considérés comme des catégories que l’on peut rassembler sous la notion de risque. Cette approche du social en termes de risque a une conséquence fondamentale : elle permet de passer d’une appréhension des comportements – quelque chose de subjectif – à une appréciation des situations objectives. Ce passage du subjectif à l’objectif va transformer complètement la vision que l’on avait des difficultés dans la société. On arrive à ce qu’on a appelé des ‘formes de socialisation de la responsabilité’ – car le risque a pour caractéristique de pouvoir être calculable. Le risque est un fait social, c’est une situation individuelle qui constitue un fait social. Les problèmes individuels peuvent donc être traités par des techniques collectives.
Cette double révolution intellectuelle – révolution sociologique et cette considération des situations sociales à partir de la catégorie de risque – vont ébranler très profondément le traitement des questions sociales et lui donner tout d’un coup un élan inconnu.
Une révolution politique et une révolution institutionnelle
La révolution politique à l’œuvre à la fin du XIXe siècle et au début du XXe est de deux ordres. Elle tient d’abord à la peur des révolutions, centrale dans l’imaginaire collectif en Europe. En France en 1893, les élections voient tout d’un coup une montée en puissance du parti ouvrier français. La peur est encore plus forte au lendemain de la guerre de 1914. Même les forces conservatrices considèrent alors que s’il n’y a pas d’innovations sociales radicales, un danger existe de voir la société basculer. L’avènement de la révolution bolchevique en 1917 ne fait que renforcer cette vision. Pour éviter la révolution, il faut faire de grandes réformes sociales. Partout en Europe l’analyse est faite de façon simultanée. Un autre facteur s’y ajoute après 1918 : le sens d’une solidarité nécessairement accrue après l’effort de combat mené en commun. La fraternité dans les tranchées ne peut que se retrouver dans les institutions sociales. En 1945 ce sera la même chose. Après une révolution intellectuelle, c’est donc deux formes de révolution politique liées aux évènements : de telles épreuves ont été vécues par la société et les risques politiques sont tels qu’il faut être extrêmement audacieux en matière de solidarité.
La révolution institutionnelle est elle aussi double. La première est liée à la révolution intellectuelle : parler en termes de risque, c’est bien sûr ouvrir la voie à la gestion des problèmes sociaux et de la solidarité à travers la technologie assurantielle. Quelles que soient les modalités, l’évolution finalement très rapide vers le développement des assurances sociales – tout va se jouer une trentaine d’années – vers le développement des assurances sociales va être fondamentale. La deuxième révolution institutionnelle, moins connue, est ce que l’on peut appeler la révolution de la redistribution. Partout dans le monde développé, l’impôt sur le revenu est créé aux alentours de 1910-1914 selon les pays – impôt qui avait pendant très longtemps été considéré comme impossible à mettre en oeuvre. Cet impôt sur le revenu est créé avec des taux extrêmement faibles. En France en 1914, il ne concerne que 20 % de la population et le premier taux est de 1 %, le taux le plus élevé 7 %. À noter, que ce taux de 7 % a été considéré à l’époque par certain comme un taux confiscatoire qui faisait presque de la France un pays communiste, disaient-ils. Mais la même expérience est faite aux États-Unis, et ce sont les mêmes taux. En Grande-Bretagne également.
Partout les taux sont au départ extrêmement bas, mais il est stupéfiant d’observer qu’en trente ans, ils vont passer de quelques pourcents à 60, 70 %, voire à 92 % aux États-Unis. Dans ce pays en 1913, le taux d’imposition maximal supérieur de l’impôt sur le revenu est de 6 %. En 1918 il est de 77 %. Il baissera ensuite dans les années trente, mais dès la fin des années trente il monte à 90 %. Le taux marginal supérieur d’imposition sur le revenu sera jusqu’aux années 1973 de 70 % ! C’est Reagan qui l’a descendu jusqu’à 28 %, avant sa remontée à son taux actuel de 35 % et, comme vous le savez, le programme de Barak Obama est d’essayer de le remonter pendant sa mandature à 39 %. En France aussi, une explosion extraordinaire a lieu : en 1915, le taux maximal supérieur est de 2 % ; il est de 60 % en 1924 et n’oublions pas que jusqu’à 1985, il sera de 65 %. Pour la Grande-Bretagne les chiffres sont encore plus frappants : au moment du gouvernement de Clement Attlee au lendemain de la seconde guerre mondiale, le taux d’imposition marginal supérieur des revenus du capital est de 98 % ; il ne passera en dessous de 80 % qu’après l’élection de Madame Thatcher.
S’est donc produit un phénomène qui apparaît incroyable à distance : en trente ans, une extraordinaire révolution de la redistribution a eu lieu. Quand on observe ces chiffres et qu’on constate le rapport actuel à l’impôt, on se pose évidemment des questions. Comment une augmentation si brutale et importante a-t-elle été possible ? Et pourquoi des taux deux fois plus faibles apparaissent-ils aujourd’hui difficilement supportables ? J’essaierai plus loin de donner un élément de réponses à ces questions. Il me semble dans tous les cas que nous vivons aujourd’hui la fin du cycle redistributif assurantiel. Le rapport à l’impôt a manifesté un retour en arrière et nous avons connu dès le début des années 80 la crise, toujours actuelle, de l’État providence.
Les causes de la fin du cycle redistributif assurantiel
Pour comprendre ce qui a changé, les éléments de type sociologiques sont peut-être parmi les plus importants. On est en effet revenu à la vieille question des comportements avec une tendance nouvelle à faire dépendre la solidarité d’une analyse des comportements d’autrui. C’est ce qui a lieu pour l’État providence à travers ce que j’ai appelé la déchirure du voile d’ignorance. La catégorie de risque n’apparaît plus simplement comme une donnée objective , mais on distingue derrière elle les comportements : derrière le malade, on voit aussi parfois le fumeur, ou derrière l’accidenté, le mauvais conducteur. On observe et discerne donc des comportements qui peuvent éventuellement être jugés, discutés ou critiqués.
Mais il y a aussi un sentiment tout à fait nouveau dans nos sociétés : l’impression que l’homogénéité peut seule fonder la solidarité. L’hétérogénéité de la société fait qu’y prospère désormais la défiance. On constate la multiplication des replis, les séparatismes locaux et nationaux. Comme si, d’une certaine façon, le recul des institutions de solidarité, le recul de ce cycle redistributif assurantiel, étaient liés à la fin de la perception d’un certaine homogénéité dans les sociétés industrielles. Le cas le plus exemplaire est celui des pays scandinaves. Ces pays étaient à la fois les champions de l’État providence et de la redistribution, mais aussi les champions de l’homogénéité et du conformisme culturel de par une culture religieuse très unie pour chaque pays et de par l’origine de leurs habitants. Le choc de l’immigration a introduit des formes de diversité qui ont ébranlé de façon radicale ce sentiment de solidarité parce qu’il était indexé sur une vision de l’homogénéité. Ce rapport entre déclin de l’homogénéité, avènement d’une société de la diversité et fin du cycle redistributif assurantiel est fondamental et doit être considéré.
Un deuxième élément est la transformation du mode de production, avec ses effets de désagrégation conjugués aux précédents. La caractéristique du mode de production industriel classique est qu’il produit des effets d’agrégation. Le travail à la chaîne prend des individus différents et les rend semblables sur la ligne de production ; il utilise ce qu’il y a de commun entre eux, à savoir la force de travail seulement. Tout le mode de production industriel produisait ainsi une forme d’homogénéité et d’agrégation sociale. À l’inverse aujourd’hui, le mode de production moderne consiste non pas à mobiliser ce qu’il y a de commun à chaque individu, mais ce qu’il y a de particularité en lui. Le capitalisme moderne a besoin de disponibilité, d’inventivité individuelle, de la possibilité de trouver une solution immédiate à un petit problème de fabrication, et non pas simplement de la capacité à suivre, de façon répétitive et sans avoir d’initiative, un processus de production. Aujourd’hui une caissière de supermarché ne ressemble absolument pas à un travailleur ouvrier spécialisé sur la chaîne. Le travailleur O.S sur la chaîne est totalement pris en charge par le processus de travail qui s’impose à lui, alors que même une caissière de supermarché, emploi pourtant très peu qualifié, a un rapport d’interaction, de face à face avec un client. Elle a à gérer une tension psychologique, une erreur sur un prix, une décision à prendre pour savoir si elle appelle ou si n’appelle pas la responsable des caisses. Il y a ainsi une transformation radicale : la perception d’une communauté de travail et d’une homogénéité des situations a changé. Aujourd’hui le social se manifeste beaucoup plus sous la forme de communauté d’épreuves, de principes de construction, que sous la forme simple d’agrégation.
Une crise morale de la solidarité
Il y a enfin un troisième élément explicatif, lié aux deux précédents de cette crise du modèle assurantiel redistributif. C’est tout simplement une crise morale de la solidarité. Insensiblement est apparu un nouveau rapport de nos sociétés à l’égalité et à l’inégalité. On ne peut pas parler de solidarité aujourd’hui si on ne regarde en face ce fait fondamental d’une nouvelle forme de consentement à l’inégalité dans nos sociétés. Alors que pendant très longtemps, à la suite de Tocqueville, s’est imposée l’idée de l’égalité comme une marche silencieuse mais continue dans l’histoire, on constate aujourd’hui un grand divorce sur cette question. Coexistent en effet un sentiment renforcé de l’égalité dans certains domaines et un sentiment abaissé de l’égalité dans d’autres. L’égalité redistributive recule, alors que l’égalité de statuts, de reconnaissance, ou l’égalité de ‘respect’ – pour employer ces mots très présents aujourd’hui – progresse. Un manquement au respect ou à un égal respect apparaît désormais dans nos sociétés absolument insupportable, alors que certaines inégalités de revenu en revanche paraissent beaucoup plus facilement supportées. Face à cela, on voit d’abord le développement de perversions de la solidarité. L’une nous vient des Etats-Unis, mais a connu ses riches heures en France aussi ; l’autre relève d’une histoire générale des sociétés industrielles.
J’appelle la compassion de substitution la forme de perversion de la solidarité venue des États-Unis. Autant la compassion a été un mot important dans le vocabulaire de la philosophie morale des XVIIe et XVIIIe siècle, autant il a totalement changé de sens lorsqu’il a été repris par les conservateurs américains dans les années. Un sociologue américain, Marvin Olasky, a publié plusieurs ouvrages sur The American compassion préfacés par Georges W.Bush. Son message était que face à un État providence/assistance qui coûtait trop cher, il fallait désinstitutionnaliser la solidarité et revenir tout simplement à la charité individuelle. À rebours des machines très lourdes il fallait, au contraire, favoriser le sens individuel de la proximité. Que le sens individuel de la proximité soit fondamental, c’est évident. Il n’y a pas de solidarité sans cette idée bien expliquée par Paul Ricoeur qu’être proche de quelqu’un, ce n’est pas simplement être son socius, mais aussi être et se faire son prochain. Mais la vision du conservatisme compassionnel est véritablement une perversion de l’idée de l’attention à autrui car elle préconise la destruction méthodique des institutions de la solidarité.
La deuxième perversion de la solidarité est ce que l’on peut appeler les solidarités d’exclusion. L’Europe notamment a connu ces formes de solidarité à la fin du XIXe siècle. Alors que la première mondialisation produisait tous ses effets à partir des années 1885-1886, partout en Europe se sont développées des formes de xénophobie et de nationalisme. Face à la croissance des inégalités à cette époque, la réponse n’a pas été la solidarité, mais la recherche de boucs émissaires. Pour la première fois dans l’histoire, on a développé ce que l’on a appelé le nationalisme. La Nation, qui était un mot symbole de la construction d’une proximité, d’une solidarité, d’une égalité interne, s’est dès lors définie uniquement par ce qui l’opposait à autrui. Une Nation définie par le rejet et non plus par la solidarité, voilà ce qui a été tout simplement l’invention du nationalisme.
Trois pistes d’avenir
Face à ces perversions, quelles peuvent être les pistes d’avenir ? J’en ouvrirai trois. Tout d’abord, dans le capitalisme d’un type nouveau que nous vivons désormais, redonner un sens accru à la notion d’attention à la particularité. Ce n’est plus simplement par des règles générales que peut se gérer la solidarité, parce que les accidents de la vie ou les situations de difficulté sont de plus en plus de l’ordre de la particularité. À l’âge du capitalisme de la particularité, après le capitalisme de la généralité, il faut redonner son sens à l’attention aux singularités. Conséquence institutionnelle très importante : le besoin de nouveaux rapports de combinaison entre le monde public et le monde associatif – un monde public assimilé au monde de la règle, même si ce dernier est en train de changer aussi ; on le voit bien avec la mise en place de Pôle Emploi aujourd’hui. Il ne s’agit plus simplement d’envoyer des chèques de prestations chômage et de vérifier des situations juridiques, mais aussi d’essayer de faire suivre par des conseillers individuels des personnes dans des situations de manque d’emploi. Mais le travail d’attention, de proximité et de resocialisation est tel qu’il faut nécessairement aller vers un développement des rapports entre le monde associatif et le monde public, en les considérant comme deux formes et deux moments nécessairement complémentaires.
L’autre réflexion à reprendre est celle des taux d’imposition et de la légitimité d’une société de la redistribution. Car s’il existe toujours aujourd’hui des formes de redistribution, celles-ci sont, de façon croissante, considérées comme illégitimes, et pas simplement par les plus aisés des possédants. Cette question est fondamentale, mais il ne faut jamais oublier en même temps que la révolution de la redistribution au début du XXe siècle n’a été rendue possible que par des révolutions d’ordre sociologique et politique. On ne peut donc refaire aujourd’hui des institutions solidaires sans une société qui ne soit davantage marquée par les impératifs de la citoyenneté. Pour le dire autrement, on
ne peut pas faire une société plus solidaire si on ne refait pas du tissu démocratique. Cela est absolument fondamental.
Aujourd’hui si la difficulté principale est de l’ordre de la légitimité collective, refaire de la légitimité, c’est toujours refaire de la citoyenneté. À cet égard, cela implique de considérer que l’objectif de la solidarité n’est pas simplement d’ordre matériel, mais qu’il reste toujours de faire société. N’oublions jamais cela, c’est peut-être parce que les institutions étaient puissantes qu’on a fini par considérer à certaines périodes que la marque véritable de la solidarité étaient les mécanismes allocatifs. Mais non ! La marque de la solidarité, c’est la qualité de la société. Redonner un sens fort à la solidarité, tout en lui redonnant à la fois légitimité et assise économique accrue, passe par cet impératif de re fa i re de la citoyenneté et de refaire du tissu démocratique.
Débat
Table des questions* : Votre exposé a visiblement reçu l’adhésion de l’assistance ; l’approche historique a beaucoup séduit. Mais certains restent un peu sur leur faim. Plusieurs questions portent ainsi sur le fondement révolutionnaire . Un semainier demande si l’une des causes premières de la perte de solidarité à partir de la Révolution ne tient pas fondamentalement à sa vision à la fois individualiste et anti-chrétienne. Par ailleurs, comment expliquer le passage du lien de fraternité révolutionnaire, qui a duré relativement peu de temps, à la notion de solidarité ?
Pierre Rosanvallon : Sur ce problème de l’individualisme et de la culture chrétienne dans leur rapport à la Révolution, je dirais qu’il ne faut pas avoir une vision de l’individualisme uniquement comme un atomisme. La valorisation de l’individualisme a été fondamentale pendant la Révolution française, mais c’était aussi le cas de la solidarité, tout comme l’individualisme est aussi une valeur fondamentale chrétienne. Dans les deux cas, il apparaît comme une valeur de construction des individus qui permet de les reconnaître comme des personnes autonomes et solidaires. Le problème est que la double reconnaissance des valeurs de l’individualisme et de celles de la solidarité crée une tension. En effet, la valeur de l’indépendance, de l’autonomie, de la particularité de chacun, se fait nécessairement par un principe de distanciation du monde commun, alors que la solidarité renvoie à un principe d’agrégation. Dans toute société, il y a de fait une tension entre l’autonomie comme distance et la solidarité comme participation. Ce sont deux valeurs aussi importantes l’une que l’autre, mais en tension permanente – et non en opposition. Faire une société d’individus autonomes, voilà le but !
— Vous n’avez pas évoqué la manière dont cette histoire se conjugue avec l’enseignement social de l’Église, notamment le rôle que les encycliques de la fin du XIXe siècle, tout particulièrement Rerum Novarum…
Il faut selon moi distinguer ce qui est de l’ordre du rappel à l’ordre moral, de l’appel à une vigilance, à une attention aux questions sociales, et ce qui est de l’ordre d’une création institutionnelle. Les encycliques ont joué un rôle très important pour montrer quels étaient les impératifs de justice, les priorités et les urgences. Mais ce n’est pas en leur sein que s’est faite la création institutionnelle. Celle-ci s’est faite dans des milieux intermédiaires, typiques de ces milieux réformateurs qui ont inventé les institutions sociales modernes en France. Par exemple le milieu du Musée social : des hauts fonctionnaires généreux et bricoleurs, des chrétiens sociaux, des républicains assez ouverts d’esprit. Les sociologues montrent très bien que les réformateurs sont toujours des « marginaux sécants », c’est-à-dire des gens à la fois très présents dans un milieu et qui ont un regard latéral. Ainsi on trouvait au sein du Musée social le monde de Le Play, celui du Comte de Chambrun, Léon Bourgeois et ses amis, des syndicalistes, des économistes ou des sociologues. Ce sont donc ces milieux qui sont importants dans le processus d’invention d’institutions nouvelles.
* Nathalie Sarthou-Lajus, rédactrice en chef adjointe du mensuel Etudes, présidait et animait cette séance. À la table des questions, François Eck et Luc Ziegler, membres du Conseil des Semaines sociales de France, relayaient les questions des participants.
— Des participants disent leur surprise devant le phénomène de yoyo en matière de taux d’imposition sur les revenus et les niveaux extrêmement élevés qui ont pu être acceptés à certains moments. Comment les expliquer ?
Peut-être faut-il une petite explication technique sur les taux d’imposition. On ne peut pas comprendre les taux très élevés que j’ai cités sans rappeler qu’ils n’étaient pas de même nature que maintenant. Par exemple, aux États-Unis en 1913, le taux de 7% ne s’appliquait qu’aux personnes ayant un revenu de plus de 500 000 dollars par an, c’est-à-dire une somme considérable. Le propre de ces taux d’imposition très importants est qu’ils étaient très différenciés selon les catégories de revenus ; ils ne concernaient que quelques milliers de personnes. Aujourd’hui le taux maximal supérieur de l’impôt sur le revenu concerne beaucoup de gens. La très grande différence de la structure fiscale de l’époque a permis que les taux d’imposition passent de 50 à 90 % à l’intérieur du millième des contribuables les plus imposés. C’est une progressivité considérable mais tout en haut de l’échelle des revenus, alors qu’aujourd’hui, il y a au contraire un écrasement et une diminution du nombre des catégories imposées. C’est néanmoins un fait qu’y compris aux États-Unis, il y a eu ces formes d’acceptation.
— En élargissant le champ géographique de nos réflexions, peut-on dire que les régimes communistes ont pratiqué la redistribution ?
Oui, on peut dire qu’ils ont pratiqué une certaine forme de redistribution, mais tout en étant justement dans le même temps des symboles de la dépendance. Les communistes ont réalisé ce que disaient les réformateurs conservateurs des années 1830 : ils ont fait de la solidarité au prix de l’esclavage. Le baron Joseph-Marie de Gérando est paradoxalement un bon prédécesseur d’un certain nombre de praticiens communistes.
— Du point de vue international, quand et comment s’est imposée à l’opinion publique française l’idée que la solidarité avec le Tiers- Monde était nécessaire et qu’il fallait y consacrer plus d’argent que ce qui était déjà donné ?
Le grand problème aujourd’hui est justement qu’il n’y a jamais eu de perception de la nécessité d’un solidarisme redistributeur vis-à-vis du Tiers Monde. Il n’y en a même pas en Europe. Le budget européen représente environ 1 % du PIB de l’Europe ! L’Europe n’est pas un espace de redistribution, jamais le début d’une forme redistributrice n’a été mis en oeuvre et les nations elles-mêmes ont du mal à rester fortement redistributrices. Si on considère que l’Europe est un espace d’expérimentations, elle devrait être au moins l’espace d’expérimentations d’une mondialisation réussie, c’est- à- dire une mondialisation réussie qui met en oeuvre des formes de redistribution. Hélas, ce n’est pas le cas.
— Deux questions plus centrées sur l’actualité de notre société. La première : comment expliquez-vous que notre société accepte de financer les solidarités au mépris de la solidarité avec les jeunes générations ?
Cette question de la solidarité entre les générations est fondamentale. Mais il faut bien reconnaître qu’il y a là une caractéristique du modèle français : c’est un modèle qui régule sa solidarité sociale par les conditions d’accès à un modèle central. Eric Maurin l’a très bien montré dans son livre La peur du déclassement . Au lieu d’avoir de vraies formes de redistribution, il y a une redistribution de fait entre ceux qui ont accès à un certain nombre d’avantages et de conditions et ceux qui restent à la porte du système. Plus on a mis de temps pour s’intégrer dans ce système central, plus on est attaché à conserver ses avantages en maintenant à distance les primo- accédants. Dans le système français, bien plus qu’ailleurs en Europe, c’est par le maintien des jeunes à la lisière du système que se fait la régulation de la solidarité. C’est donc une régulation par l’exclusion générationnelle.
— La seconde question fait état des politiques publiques de prévention : ne sont-elles pas insuffisantes ?
Le principe de prévention est un peu le cousin du principe de précaution. Croire que l’on résoudra tous les problèmes par le principe de prévention est une erreur. Le principe de prévention au contraire peut être la façon de multiplier à l’infini des dépenses pour des résultats incertains. S’il est très bon de manger cinq fruits et légumes par jour, et tout un ensemble d’autres choses que l’on nous conseille de faire tous les jours, imaginer que la voie de la réduction des dépenses sociales et collectives passe par une absolutisation du principe de prévention me semble très discutable . Deux chercheurs de l’INSERM, Patrick Peretti-Wattel, Jean-Paul Moati, viennent de publier un livre sur l’idéologie de la prévention qui l’explique très bien.
— Un thème revient fréquemment dans les réflexions et questions des participants : les inégalités de revenu ou de rémunération, le décalage entre les bonus des traders, les stocks options des patrons et les huit millions de français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vous affirmez dans votre intervention que nos sociétés sont devenues peu sensibles aux inégalités de revenu ; n’y a-t-il pas pourtant aujourd’hui un très fort rejet des rémunérations aberrantes ?
Certes, il peut y avoir un consensus dans les sociétés européennes pour critiquer ces bonus extravagants, mais il ne faudrait pas que cette critique fasse passer pour normal toutes les autres inégalités et hiérarchies des revenus. Il est très facile de se mettre d’accord partout sur ce thème et j’espère que des actions pourront être entreprises. Mais le problème est beaucoup plus large : c’est celui d’une tolérance plus grande aux inégalités, indépendamment de ces bonus. Je ne vois pas protester contre les rémunérations importantes dans le sport, le spectacle et même dans l’entreprise. Le premier ouvrage que j’ai écrit quand j’étais syndicaliste à la CFDT avait un titre très années 70 : Hiérarchie des salaires et lutte des classes. C’est donc une question que je connais bien. À l’époque, en 1972, les modernistes du patronat venant de la fonction publique, comme François Bloch-Lainé, considéraient comme un objectif raisonnable d’aller vers un resserrement de la hiérarchie des salaires de un à six ; on en discutait au sein du CNPF… Il y a quelques jours, j’entendais Jean-Luc Mélenchon, le représentant du Parti de gauche, appeler à se battre pour arriver à un écart de un à vingt ! Même François Bloch-Lainé était trois fois plus révolutionnaire que Jean-Luc Mélenchon en 1970. Cela fait réfléchir : pourquoi en sommes-nous là ? Cette situation ne s’est pas imposée du dehors ; il y a tout simplement, une forme d’acceptation sociale. D’où provient-elle? Je pense qu’il y a des facteurs objectifs et des facteurs idéologiques. Parmi eux, il y a le passage d’un capitalisme de la généralité à un capitalisme de la particularité.
Dans le capitalisme classique – de la généralité – les rémunérations étaient indexées sur un effort considéré comme indissociablement collectif. Dans le capitalisme de la particularité, le capitalisme des managers d’aujourd’hui, on pense que les rémunérations et les résultats d’entreprise peuvent être décomposés dans les apports différentiels de chacun, ce qui est très différent du modèle précédent. Ce sont donc des questions de légitimité qui sont à l’œuvre et c’est pour cela qu’une révolution intellectuelle et morale est fondamentale aujourd’hui. Avant de penser en termes d’ingénierie sociale des formes de solidarité, il faut véritablement mettre l’accent sur cette nécessité de reconsidérer dans leurs fondements intellectuels et moraux les questions de la solidarité.
—Vous n’avez pas mis l’accent sur le rôle du mouvement ouvrier, et plus généralement des syndicats…
Je le reconnais, mais dès que l’on parle des institutions de la solidarité, il est évident que le mouvement syndical a été au cœur de leur fabrication et de leur production. Toute la société assurantielle est liée à son combat, de même pour la législation sociale. J’aurais pu parler de tous ces acteurs, mais il aurait également fallu expliquer les forces politiques à l’œuvre en arrière-plan – ce que j’ai fait en évoquant que la révolution politique était une révolution de l’organisation sociale – une révolution liée à celle du mouvement ouvrier, cela va de soi.
— Dans la fresque historique que vous avez brossée, vous avez parlé de la révolution politique et des innovations sociales nées d’une part de la peur des révolutions, d’autre part, de la fraternité des tranchées. Un de vos auditeurs attentifs vous pose la question : comment rendre actuelle la fraternité dans les tranchées ?
S’il n’y a plus les tranchées, il pourrait cependant y avoir le sentiment d’autres types de dangers communs, celui d’une sorte de dissolution des sociétés… Aujourd’hui, ce qui menace nos sociétés, ce ne sont pas des explosions, mais des séparations douces, des formes d’implosion. C’est sur cette multiplication des implosions que nous devons faire porter notre vigilance.
— Une participante nous dit : aujourd’hui, tous les ingrédients paraissent présents pour faire éclater une révolution ; pourquoi n’éclate-t-elle pas ?
La réalité de la vie sociale aujourd’hui, ce sont ces formes de décomposition dont j’ai parlé; une révolution supposerait au contraire des formes de ressaisies collectives. Il peut certes y avoir à nouveau des ‘insurrections du cœur’, mais il n’y a guère aujourd’hui de formes de ressaisies collectives. On assiste surtout à des phénomènes de ségrégation et de séparatisme. Les Flamands ne veulent plus vivre avec les Wallons ; les Italiens du sud ne veulent plus vivre avec ceux du nord ; les gens se séparent dans leur quartier, ne vont plus dans les mêmes écoles… Il y a des micro et des macro-séparatismes partout. Nos sociétés cherchent à se recomposer à travers des petits îlots d’homogénéité. On n’essaie pas de refaire une nation qui fasse sens, mais des petits groupes dans lesquels on se ressemble. Or la démocratie de la ressemblance est l’ennemie de la démocratie. La démocratie a été inventée au moment où les cités grecques, gouvernées par les tribus, par les traditions, se sont ouvertes aux étrangers avec le développement du commerce maritime. Pour gérer la diversité, les différences, il ne suffisait plus de faire appel à la tradition, aux autorités constituées, au pouvoir ancestral de la tribu; il fallait trouver des façons de se parler, de se comprendre, de vivre ensemble. Aujourd’hui, nous revenons à ce risque des petits groupes homogènes. Il ne faudrait pas réduire la démocratie à des assemblées de copropriétaires dans les immeubles, c’est-à-dire des gens qui se ressembleraient et gère raient ensemble des intérêts communs.
• Téléchargez le pdf